20:00
Thèses et interrogations pour une histoire réconciliée de la Mauritanie
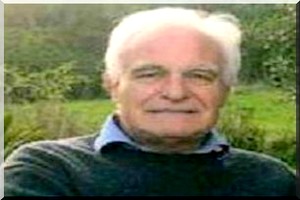
Le Calame - Tandis que je prépare l’édition des chroniques de ce journal, pour les grandes dates de la Mauritanie contemporaine, et que vont reprendre une seconde série de ces anniversaires mais centrée sur la période 2005-2010 ayant donné naissance à l’état de fait actuel, ainsi que la publication de documents diplomatiques français sur la guerre du Sahara, il m’a semblé utile de faire le point sur l’ensemble de l’histoire nationale, en forme de synthèses mais, aussi, de questions.
Celles-ci sont ouvertes au dialogue des lecteurs : b.fdef@wanadoo.fr ou aux bons soins du journal qui transmettra.
I – Une fondation pérenne
De mémoire d’homme aujourd’hui, la Mauritanie est passée, d’une histoire millénaire stable, depuis l’arrivée des Maq’il et la fin des grands empires soudano-sahéliens, à une période d’une autre stabilité, paraissant tout aussi durable, celle de l’administration étrangère, française.
Ces deux périodes continuent de marquer le pays, autant que sa géographie et la nature de sa faune, de sa flore, de ses ressources minérales et halieutiques. La répartition des populations, la pauvreté générale, les écarts très grands de richesse, entre Mauritaniens, et d’influence, sur le destin commun, n’ont pas changé. C’est une première thèse, si l’on entreprend de raconter et, surtout, de comprendre l’histoire du pays.
Il y a un fond commun à tous et commun aux différentes générations, passées ou actuelles. L’interrogation porterait sur la fragmentation des histoires et des mémoires collectives selon les groupes ; sur l’interpénétration, la synthèse possible de ces mémoires et histoires ; et sur la question de savoir si elles préparaient, ensemble ou pas, une conscience nationale.
Certitude, en revanche : un projet d’Etat (1) s’est offert à cette conscience latente ou possible et c’est le fait de l’étranger, d’une administration française qui – c’est aujourd’hui perceptible, au regard des régimes autoritaires prévalant, à quelque quinze mois près de tentative démocratique, depuis bientôt quarante ans – n’a duré qu’une grande cinquantaine d’années.
Donc pas très longtemps. Tandis que les pouvoirs à base militaire et putschiste semblent devoir durer bien davantage. Ce projet reste la matrice de toutes institutions publiques mauritaniennes, depuis la fin des années 1950.
Et, tout aussi pérenne, un assemblage territorial, datant des années 1920 et 1944 (fin des essais de cercles du Chemama pouvant fusionner, politiquement, les deux rives du fleuve Sénégal et rattachement du Hodh), sur lequel n’est revenu qu’un très court moment (Février 1976 à Août 1979) la réunification du Nord-ouest, très partielle, avec l’intégration du Tiris el-Gharbia dans la République Islamique de Mauritanie. L’ajustement selon le traité de Kayes, en Février 1965, n’a été qu’une mise en cohérence de la « chaîne » des puits entre Mali et Mauritanie.
Ces deux legs de la « période coloniale » n’auraient pu constituer la Mauritanie contemporaine, sans un assentiment et une pratique des Mauritaniens eux-mêmes. La gloire du fondateur qu’a été Moktar Ould Daddah est d’avoir compris que cet héritage d’une domination étrangère, pacificatrice mais expropriant les Mauritaniens de toute décision sur eux-mêmes, pouvait produire une nation.
Pour donner – très vite – réalité à cette intuition, à cette prophétie, il a fallu que plusieurs éléments se rencontrent, providentiellement, à la fin des années 1950 et au début des années 1960 : disons, de la formation du premier gouvernement mauritanien, encore subordonné au représentant de la métropole (2) à la résolution des « événements de Janvier-Février 1966 », confirmant les acquis du congrès « historique » de Kaédi, tenu en Janvier 1964.
Le premier élément a été que cette formation gouvernementale, ce congrès et ces événements ont fondé puis confirmé le rôle de Moktar Ould Daddah, en tant que catalyseur de la naissance du nouvel Etat-nation.
La personne-même du premier chef de gouvernement (3), le désintéressement de Si El Moktar N’Diaye pour ce poste, alors qu’il jouit au début d’une notoriété et d’une autorité supérieures à celle du nouveau venu en politique, enfin l’attitude de la France, des débuts de l’autonomie interne jusqu’à la guerre menée par la Mauritanie, en même temps que le Maroc, pour le Sahara occidental, ont tous trois concouru à la stabilité de tous les paramètres publics pendant vingt-et-un ans.
Si l’enfant de bonne tente à Boutilimit et l’un des trois seuls bacheliers du pays, en 1957, n’avait pas été aussi net que Moktar Ould Daddah le fut, en imposant, à la métropole, le décret faisant, de Nouakchott, la capitale du pays et impliquant les financements indispensables, en définissant, en termes limpides devenus historiques, la situation et la vocation mauritaniennes (4), en appelant au consensus des partis, manifesté par l’ouverture des postes ministériels à toutes les tendances, dès 1957 et, encore, en 1960 et 1961, en confirmant l’égalité d’appartenance et de contribution à la construction nationale de toutes les ethnies et classes sociales du pays… la Mauritanie ne serait pas née, elle eût été ou tout autre ou réduite à une éventualité non choisie par les Mauritaniens et par L’histoire, faute qu’elle leur ait été vraiment proposée, énoncée, puis garantie, par deux décennies d’une persévérance personnelle.
Il faut ajouter, à ce premier élément fondateur, la personnalité même du Président : absolue fermeté, sur les objectifs et les caps, même quand ceux-ci sont une projection future et restent incertains.
De l’indépendance à la réunification, tout a tenu à une détermination impavide, celle de Moktar Ould Daddah. Mais cette rigueur sobre a porté tout autant sur les comportements, les siens, et ceux imposés à ses co-équipiers, à toutes époques de son exercice du pouvoir suprême : honnêteté financière, transparence et partage des débats et des décisions. Moktar Ould Daddah n’avait pas un sou d’économie ni, a fortiori, de comptes bancaires à l’étranger, quand il fut renversé.
Il finança souvent les vacances familiales d’hivernage, en empruntant à celui de ses collaborateurs français, auprès de lui du début à la fin : l’exceptionnel Abel Campourcy, le remboursant évidemment, construisant, par prêts d’une banque nationale, sa résidence privée qu’il mit, d’ailleurs, constamment à la disposition de l’Etat, quand il fallait héberger des hôtes importants.
Un régime et un mode de gouvernement délibératif, moyennant deux forts encadrements. Pour la généralité, celui du Parti unique de l’Etat, dont le monopole fut sincèrement avoué et développé, au lieu que le contraire soit prétendu par les systèmes qui succédèrent à celui-là.
Et, pour les débats-même, par le fait qu’en conseil de ministres et en bureau politique national, a fortiori en comité permanent, on ne votait pas et le Président s’exprimait en dernier, ce qui n’embarrassait par ce dernier, s’il se trouvait, manifestement, en minorité ou seul de son avis, et ce qui permettait, à chacun, de s’exprimer sereinement, sans esprit de cour non plus.
Sans doute, deux questions difficiles – celles des garanties institutionnelles, réclamées par certains représentants des compatriotes originaires de la Vallée du Fleuve, lors du congrès dit de l’Unité, tenu en Décembre 1961, et, en fin de période, le partage de l’ouest du Sahara qu’administrait l’Espagne et l’engagement militaire imposé, par l’Algérie, au partenaire supposé le plus faible – ne firent pas l’objet de débats.
Pour la première, une commission ad hoc, au sein du B.P.N., travailla sans solution satisfaisante et la succession de deux congrès clivant et marquant rejeta, de l’ordre du jour, le sujet. Celui-ci n’y revint que par la discussion des programmes scolaires et de la place de l’arabe dans l’enseignement national.
Discussion qui ne fut pas à l’initiative du pouvoir mais de la jeunesse collégienne puis d’une partie des élites politiques, au printemps de 1966. Entretemps, la question dominante avait été institutionnelle : l’Assemblée nationale l’emporterait-elle sur le Parti ou le contraire, ce qui fut résolu par le congrès extraordinaire de Kaédi.
Quant au Sahara, le partage et ce qu’il apportait au pays parurent de très bonne aubaine. Puis la guerre fut l’évidence d’un honneur et d’une dignité qu’avait mis en doute le dramatique ultimatum donné, par le président Boumedienne, à son homologue mauritanien dont il trahissait, à l’improviste, une confiance si souvent manifestée par Moktar Ould Daddah, à partir de l’été de 1967 (5), et en faisant oublier, à l’Algérie, le soutien sans faille de la Mauritanie à sa cause indépendantiste, dès 1956, ce qui, en Afrique d’expression française, fut une exception.
Le second élément fut très vite une preuve de l’autorité morale du jeune chef de gouvernement, pourtant novice en politique et en gestion, et, aussi, la belle manifestation de la capacité des élites mauritaniennes à dépasser les habitudes et intérêts de tradition et à commencer de pratiquer un véritable patriotisme.
Le député au Parlement français et président de l’Assemblée territoriale puis nationale – explicitement, le principal parrain politique de Moktar Ould Daddah, en 1956-1957, ce que reconnaît ce dernier – ne brigua pas la place exécutive et gouvernementale.
Quoique réservé, sur la marche à l’indépendance, à l’instar de la majorité, d’ailleurs, des cadres du parti dominant puis de l’Assemblée, hostile au régime présidentiel qui le diminuerait personnellement et ne tenait pas compte d’une ambiance très délibérative entre gouvernement et parlement, opposé au parti unique, Sidi El Moktar N’Diaye ne prit la tête d’aucune opposition organisée.
Il n’est pas exagéré de dire qu’il inventa Moktar Ould Daddah, avec quelques autres, dont des Français, le sénateur Yvon Razac, et le secrétaire général du territoire Georges Poulet, tous les deux aux manettes depuis 1946.
Le génie proprement mauritanien fut qu’un instinct national, qui ne pouvait s’exprimer publiquement ni, même, se discerner dans beaucoup d’esprits, suscita la rencontre, immédiate, entre le plus nationaliste qu’ait suscité la Mauritanie, parmi ses enfants et jusqu’à ce jour : Moktar Ould Daddah ; et, aussi, bien des représentants des époques qui se périmaient, que de la jeunesse : Ahmed Saloum Ould Haïba, Mamadou Samboly Ba, Mohamed El Moktar Marouf, Bocar Alpha Ba, autant que Mohamed Ould Cheikh, Ahmed Bazeïd Ould Ahmed Miske, Aboul Aziz Sall, Ahmed Ould Mohamed Salah, Mohamed Ould Hamoni.
Les années vraiment fondatrices et cruciales, ou aucune erreur de parcours, aucun faux-pas n’était permis, ont été incarnées par ceux-là, tandis qu’à la fois, insistaient la revendication marocaine, la pétition sénégalaise et l’appétit malien, même les doutes et les agacements français. S’il existait un ordre de la naissance d’une nation : la Mauritanie ; oui, ces personnages de courage, de sincérité et d’abnégation en seraient les premiers consacrés.
Le troisième élément est la France, qui a, à tout moment – on ne l’en a soupçonnée, en Mauritanie, qu’à la suite du coup militaire du 10 Juillet 1978 et on l’attend d’elle, depuis le 6 Août 2008 – pouvait, certainement dans les années 1960 (6) et pourrait, croit-on aujourd’hui, renverser le régime de Nouakchott, ne l’a pas fait.
Ni au détriment de Moktar Ould Daddah, j’ai enquêté, sur le moment, auprès de ceux qui définissaient, à Paris, la conduite à tenir vis-à-vis de la Mauritanie (7), puis, depuis quelques années, dans les archives, rapatriées à Nantes, de l’ambassade… ni à celui de l’un quelconque de ses successeurs putschistes, sauf le colonel Mohamed Khouna Ould Haïdalla, victime du 12/12/1984, et du colonel Maaouyia Ould Sid’Ahmed Taya.
Au contraire, elle a soutenu la Mauritanie naissante, par l’opération Ecouvillon, à l’automne de 1957, qui écarta toute menace marocaine, proprement militaire, et par sa caution, auprès de la B.I.R.D., pour que soit financée la mise en exploitation des mines de fer de la Kedia d’Idjil. Elle a renouvelé cette intervention, à l’occasion de la guerre du Sahara, alors même que les accords de défense, conclus en Juin 1961, avaient cessé en Février 1973, de figurer dans les engagements liant les deux pays.
A presque tout moment de l’exercice du pouvoir par Moktar Ould Daddah, elle a eu motif de graves déplaisirs. L’indépendance, inconditionnelle et, donc, sans le préalable d’accords de coopération, mettait en porte-à-faux l’ancienne métropole, devant l’Assemblée générale des Nations-Unies, si, d’aventure, il lui eut fallu intervenir en Mauritanie.
La question linguistique fit se rencontrer, en 1965-1966, les inquiétudes des personnels de la fonction publique héritée du régime français et une forme d’émancipation mentale vis-à-vis de l’ancienne métropole : Moktar Ould Daddah sut trouver les combinaisons et aménagements acceptables par tous, en mariant des réformes scolaires et des orientations diplomatiques novatrices, tandis que le général de Gaulle, en personne, assurait la Mauritanie de ses totales indépendance et liberté, pour choisir ce que sont ses langues nationales ou de travail ou de communication internationale.
La nationalisation de Mi-Fer-Ma, entreprise à capitaux et, surtout, d’encadrement majoritairement français, puis la demande de révision des accords de coopération et, enfin, la sortie de la zone franc furent acceptées, avec aménité, par la France, même si aucune n’était ni souhaitée ni – surtout – prévues… La Mauritanie a, constamment malgré les rapports de forces objectifs, usé de comportements et d’initiatives non concertés, pouvant, chacun, passer pour de l’insolence.
Paris l’admit, sans doute parce que le pays a constamment semblé hors normes, aux points de vue stratégique et équilibres intérieurs, et, aussi, parce que la personnalité de Moktar Ould Daddah, particulièrement explicative, fut, toujours, a posteriori compréhensible et, donc, comprise ; finalement, très estimée.
C’est ce qui engagea la France, sans texte ni négociation, selon une simple convention pratique, en façon de mode d’emploi de ses avions et, aussi, de ses officiers instructeurs, à soutenir militairement le pays sur lequel s’acharna, aussitôt, l’Algérie, exclue par l’Espagne et plus encore par le Maroc, d’une aubaine saharienne archi-naturelle, pour la Mauritanie, et seulement partielle. C’est, sans doute, Valéry Giscard d’Estaing qui s’en expliqua le plus nettement.
Ces années fondatrices posent cependant des questions, quoiqu’aucune ne soit décisive de l’ensemble. Enonçons-en quelques-unes. Les premières portent sur les personnes. Les plus vives et précises furent Mohamed Ould Cheikh et Ahmed Baba Ould Ahmed Miske. Le premier, homme d’Etat avant la lettre, fut décisif par son énergie et son sens de l’organisation, contre le terrorisme favorable au Maroc et pour la construction institutionnelle et déontologique.
Sensible aux pétitions de la minorité, il s’imposait, cependant, à l’ethnie et à la société dominante, par sa rigueur. Bien plus diplomate que ses apparences pouvaient le faire croire, il a su mener les travaux de la table ronde des partis et mouvements politiques existant au printemps de 1961, jusqu’à une fusion donnant naissance au Parti du Peuple Mauritanien et à l’unicité de candidature à la présidence de la si jeune République.
Les débats judiciaires – en Cour criminelle spéciale et pour examiner le parcours des « transfuges » (8) de 1958 à 1963 – furent menés aussi par lui. Il serait superficiel de motiver la rupture, entre lui et le Président, à partir de 1966, par une rivalité ou par des divergences quasi-doctrinales. Le pays y a perdu politiquement car le retrait de Mohamed Ould Cheikh a fait disparaître une alternative à la manière de concevoir et établir le Parti unique de l’Etat et tari, certainement, le débat d’idées.
La trahison d’une partie de la hiérarchie militaire eût-elle été seulement envisagée, s’il était resté son interlocuteur gouvernemental ? Ahmed Baba Ould Ahmed Miské a rendu, lui, deux éminents services. Le premier fut de constituer une opposition nationaliste qui, en se rendant aux négociations de l’Unité, montra, rétrospectivement, le peu de fondement de la revendication marocaine.
Le second est, évidemment, d’avoir efficacement énoncé la légitimité exclusive de la Mauritanie, pour réclamer sa réunification territoriale, après les scissions coloniales de 1900 et 1902 (9). En regard, d’autres premiers rôles, tels que celui d’Ahmed Ould Mohamed Salah, ont probablement contribué à ossifier un régime qui devait rester évolutif et le serait redevenu, dès la fin des hostilités sahariennes (10). Le débat s’ouvre, alors, sur les dialogues du fondateur, avec ses coéquipiers, et précise la question de l’autonomie de pensée et de projet du Président.
Question également plus de pratique que de principe. La nationalisation de Mi-Fer-Ma fut le fruit d’une gestation intellectuelle solitaire. Le Président, à ce propos comme à celui de la révision des accords de coopération, testa – ce qui confirmait ou fragilisait la construction en cours de l’Etat mauritanien – la capacité de ses principaux ministres ou coéquipiers à garder un secret, précisément d’Etat, de secrets d’Etat.
Ce fut concluant et, pour Moktar Ould Daddah, cela resta comme une confirmation que s’établissait bien une responsabilité. Pour beaucoup de ses ministres, il était possible d’aboutir au même résultat mais autrement : en augmentant progressivement, mais assez vite, la participation mauritanienne au capital de la société.
La nationalisation a-t-elle effrayé des investisseurs potentiels, notamment pour la prospection pétrolière ? Si oui, la mise en valeur d’une des ressources du pays aurait été retardée de près de vingt ans. Il est, en revanche, certain qu’elle fit, de la S.N.I.M., un pôle important de pouvoir, de capacités logistiques et, même, de trésorerie qui prit le parti des putschistes, en 1978, ce que n’auraient évidemment pas fait les responsables d’une gestion privée étrangère, telle qu’elle fonctionna jusqu’en 1974 : partenaire difficile, en conditions sociales et en participation des Mauritaniens, à tous les niveaux, mais certainement loyal aux autorités légitimes du pays.
Pour Moktar Ould Daddah, la question se posait autrement : la nationalisation contribuerait à relancer l’unité politique, non plus entre des mouvements, mais entre générations : les jeunes étaient, évidemment, sensibles à cet Etat dans l’Etat, un Etat étranger dans le nord du pays concurrençant, de fait, leur Etat national. La nationalisation allait, surtout, permettre de soutenir la nouvelle monnaie qui ne serait plus sous garantie française mais gagée par des ressources mauritaniennes.
Questions auxquelles Moktar Ould Daddah ne donnait pas de réponse. Comment s’être ainsi trompé sur les sentiments et projets, au vrai, de son homologue algérien ? Connaisseur des Français, connaisseur des gens de Mi-Fer-Ma dont la plupart des cadres, d’ailleurs, optèrent pour la nouvelle forme de la société, connaisseur des grands partenaires du Golfe et de l’Afrique d’expression française, hôte des Algériens, à partir de 1967, et ayant totalement donné le change au roi Hassan qui s’attendait au désintéressement mauritanien du Sahara, dès lors que serait reconnue, par lui, la République Islamique et son président, accueilli à l’égal de toutes autres puissances du monde arabe, Moktar Ould Daddah qui concevait, si bien, le réalisme de ses grands partenaires et, aussi, celui des protagonistes géants de la « guerre froide » (11).
Questions auxquelles répondent, avec aisance, les successeurs immédiats – par la force – du père fondateur. Moktar Ould Daddah n’avait-il pas les moyens d’empêcher le putsch ? Et, donc, de garantir un aboutissement serein, prémédité et débattu, pour les institutions du pays, et, peut-être, le maintien définitif du Tiris el-Gharbaïa.
Les putschistes – Mustapha Ould Mohamed Saleck et Mohamed Khouna Ould Haïdalla – m’ont affirmé que le Président n’avait aucune chance. Pourtant, les plans séditieux se modifièrent et, surtout, certains des conjurés firent défection. Moktar Ould Daddah – fatalisme ou confiance ? – ne voulut pas prendre le risque d’une vulnérabilité du front, si en étaient retirés ou discutés les officiers supérieurs en place, et se confia dans ce qu’il pensait être formellement le patriotisme de ceux-ci.
Ils continueraient la guerre, dans l’intérêt supérieur de la patrie mauritanienne, et la mèneraient, peut-être, mieux que lui… Tous n’étaient pas dans le coup, si le jeu de mots peut se ainsi s’énoncer… notamment le commandant de l’aviation, Kader, et la gendarmerie n’en étaient pas, et l’une des principales autorités nobiliaires de l’armée, le colonel Ould Sidi non plus, pas plus que le colonel Ahmed Ould Bouceïf.
Il est, pour moi, certain que les évincés ou remplacés n’avaient pas, à l’époque – Juillet 1978 – l’estomac de ceux qui réagirent, en Août 2008, à leurs mutations respectives, en renversant un président qui venait d’être élu dans des conditions exemplaires, sans précédent, et saluées par tout l’étranger.
Question valant davantage pour les pustchistes que pour le président Moktar Ould Daddah, quoique les décisions aient daté de lui. Les réformes de l’enseignement tendaient, à partir de 1973, à bien davantage que la mise en œuvre de l’option du bilinguisme, adoptée par le congrès d’Aïoun el-Atrouss, en Juin 1966, pour conclure les contestations et troubles des mois précédents.
Moktar Ould Daddah, nationaliste d’orgueil et de conviction intime mais d’expression mesurée, voyait, certainement, la langue arabe prévaloir absolument dans le pays, quelles que soient les origines ethniques et sociales, le français ne demeurant, en pratique, que pour la communication internationale et certaines branches universitaires techniques et scientifiques.
Le fait est que ces réformes et évolutions ne donnèrent lieu à aucune contestation ni mouvements dans le monde scolaire et, surtout, universitaires, ni dans la fonction publique, tant que le Président était au pouvoir, mais, dès Septembre 1978, commença une agitation qui atteignit son paroxysme, en forme de rejet motivé de la dictature, en 1998, à la suite de la réélection anticipée et suspecte de l’homme fort du moment : le colonel Maaouyia Ould Sid’Ahmed Taya.
L’université échappait au pouvoir, comme, auparavant, une partie de la hiérarchie militaire s’y était résolu, contre le père fondateur.
De même, le lien de cause à effet est avéré, entre l’évolution pacifique puis légiférée de la question sociale principale (12) qu’est la persistance, en Mauritanie, des pratiques esclavagistes et la nature des régimes militaires, quelle que soit leur façade.
C’est devenu manifeste, depuis la « rectification » d’Août 2008, ignorant puis réécrivant la législation intervenue pendant la courte période démocratique. Et, dangereusement, la question a dérivé en une discussion théologique et de manifestes violations des droits de l’homme perpétrées, par le régime actuel, sur les « abolitionnistes », leurs compagnons autant que leur chef.
Et pourtant, telle quelle, la fondation s’est révélée solide, aussi bien à son tout début de 1957 qu’à son dénouement de 1978. Dès ses premières années, elle démentait les pronostics d’inviabilité, de dislocation pluri-ethnique et d’immaturité. Elle s’est confirmée, quels que furent les événements ultérieurs.
D’abord, la succession des coups militaires, dont le premier en date élimina le père fondateur et l’instrument quasi-consensuel qu’il avait donné au pays, pour que celui-ci mûrisse et que se transpose la tradition délibérative mauritanienne (le parti unique de l’Etat).
Tout autant, les formes successives du racisme, passées de revendications d’équilibres politiques à des pétitions linguistiques et devenues carrément sociales, n’ont pas mis en question l’unité nationale, malgré les dramatiques règlements de comptes du printemps de 1989, au Sénégal comme en Mauritanie, malgré les « années de braise » et les décimations de l’armée, selon des critères explicitement raciaux, malgré la recrudescence de la question servile.
Un Etat, de structures faibles et ne parvenant pas à améliorer vraiment la sécurité des revenus et de la santé de l’immense majorité de ses ressortissants, a, cependant, persisté et demeure l’espoir de beaucoup, s’il se régénère.
La fondation mauritanienne et, pour beaucoup, le souvenir de celui qui l’a incarnée sont la référence commune à tous les Mauritaniens et, probablement, la seule, puisque la mise en commun des ressources du pays, la démocratie, la promotion humaine – explicitement au programme des débuts de l’Etat-Nation et en commencement de mise en œuvre – sont, actuellement et plus que jamais, de simples mots. Pas même des slogans.
Question : alors que deux, au moins, des trois éléments qui ont concouru à la fondation n’existent plus, à savoir : 1°, une personnalité d’exception et consensuelle ; 2°, un assentiment et un concours, presque unanime, des élites traditionnelles et de la jeunesse formée, pour l’essentiel, à l’étranger, et que, 3°, la caution française est, depuis longtemps, davantage déformatrice, puisqu’elle joue en faveur du statu quo autoritaire, qu’entraînante ou sécurisante, comment la Mauritanie va-t-elle et peut-elle continuer seulement selon un élan initial ?
La réponse probable est que les régimes de contrainte s’étant succédés depuis 1978 sont appelés à disparaître, à brève échéance. Du fait de leur nature et, non plus, selon leur processus interne, chaque coup militaire étant censé – explicitement, depuis 2008 – « rectifier » la construction ou la trajectoire précédentes. (A suivre : « Les coups militaires comme rythme national ? »)
Bertrand Fessard de Foucault
Notes
(1) : L’expression est du président Moktar Ould Daddah, peut-être pas en discours public ni même dans ses mémoires – c’est à vérifier – mais, certainement, dès les premiers entretiens qu’il m’accorda, au printemps de 1965, et, probablement, en conversation avec d’autres, compatriotes ou français.
(2) : Le gouvernement présenté les 20 et 21 Mai 1957, à l’Assemblée territoriale et à la signature du Gouverneur Albert Mouragues, Assemblée constituée selon la loi-cadre métropolitaine du 23 Juin 1956 et les élections du 30 Mars 1957.
(3) : Moktar Ould Daddah, tête de liste du parti dominant, pour la circonscription nord du pays, le 30 Mars 1957, tandis que Sidi El Moktar N’Diaye, député de la Mauritanie à l’Assemblée nationale française, conduit la liste du même parti pour le Sud, est, d’abord, vice-président du Conseil de gouvernement, le 21 Mai 1957, puis président du Conseil, le 26 Juillet 1958, ensuite Premier ministre, le 23 Juin 1959, et, à partir du 26 Novembre 1960 , chef de l’Etat, enfin président de la République, élu le 20 Août 1961 et constamment réélu.
(4) : Trait d’union entre l’Afrique noire et l’Afrique blanche : thème continuellement affirmé, développé, enrichi pratiqué en vie politique intérieure et en diplomatie mauritanienne.
(5) : Les vacances familiales furent désormais vécues en Algérie, alors que, jusqu’à l’été de 1966, le couple présidentiel les prenait en France.
(6) : Par une indiscrétion du président Senghor, Moktar Ould Daddah fut prévenu que le nouvel ambassadeur, remettant ses lettres de créance, en Décembre 1963, arrivait pour le « débarquer ».
Le Président prit Jean Deniau à contrepied, en lui disant qu’il savait cela et le laissait libre d’agir et de trouver tout concours, dans tout le pays, pour accomplir cette mission ; celui-ci n’y parvint évidemment pas, proposa à Mohamed Ould Cheikh le concours de troupes françaises, pour rétablir l’ordre, en Février 1966, à Nouakchott, ce qui fut refusé, mais n’adopta, jamais vraiment, son vis-à-vis mauritanien.
Cela se comprend en lisant ses mémoires. A l’inverse, dans le premier été de son arrivée au pouvoir en France, François Mitterrand qui avait accueilli, dans sa propriété privée de Latché, le Président et Mariem Daddah, pour la Saint-Sylvestre 1980, proposa, au chef d’Etat en exil, de le « rétablir ». Moktar Ould Daddah répondit qu’il ne rentrerait jamais, dans sa patrie, entre des baïonnettes françaises. Les régimes autoritaires et l’exil du père de la nation continuèrent donc…
(7) : Enquête publiée, en forme de mon journal personnel, par Le Calame, en Juillet 2009).
(8) : Ayant disparu de Mauritanie, en Février-Mars 1958, pour aller faire allégeance au roi du Maroc, alors Mohamed V, ils sont rentrés inopinément, le 26 Mars 1963, sans pourtant troubler le premier congrès ordinaire du Parti : Mohamed Fall Ould Oumeïr, Mohamed El Moktar Ould Bah, Cheikh Ahmedou Ould Sidi et Mohamed Ahmed Ould Taki ; ils comparaîtront tous en 1965, sauf l’ex-émir du Trarza, retiré à Dakar et y décédant et Dèye Ould Sidi Baba poursuivant une très brillante carrière politique au Maroc.
(9) : Les traités franco-espagnols, analysés, notamment, par le mémoire mauritanien soutenu, devant la Cour internationale de justice en Octobre 1974 ; mémoire qu’a commencé de publier Le Calame, en Février 2016.
(10) : Le 6 Juillet 1978, donc au lendemain de sa conférence, avec les cadres de l’armée, dont la tenue et le contenu déterminèrent la tendance putschiste, Moktard Ould Daddah entretient Ahmed Ould Mohamed Salah puis Mariem Daddah des projections qu’il faisait pour l’avenir.
Ne pas se représenter en 1981, si la guerre était terminée et introduire, au sein du Parti, la pluralité de candidatures. Les deux mesures auraient confirmé la maturité du pays et de son parti. La succession à la tête de l’Etat aurait, sans doute, échu à une personnalité du Fleuve, et le pluralisme, dans le Parti, se serait manifesté par une diversification en groupes parlementaires des députés à l’Assemblée nationale.
(11) : A Tichitt, au printemps de 1974 où des avaries et des moindres rotations d’avion avaient fixé pour deux jours, inopinément, une partie de la délégation présidentielle en « tournée de prise de contacts », dans les IVème et Vème Régions, le chef de l’Etat me dressa, en tête-à-tête, un tableau saisissant des relations internationales d’alors. Pour lui, les Etats-Unis avaient, non seulement, gagné (ils avaient su abandonner leur guerre du Vietnam) mais ils avaient satellisé l’Union Soviétique
(12) : L’option judiciaire, pour des solutions cas par cas, pendant les années fondatrices, selon les recommandations diffusées par circulaires de deux ministres successifs de la Justice, la première du 5 Décembre 1969, puis le règlement au fond, par voie d’ordonnance des militaires du 9 Novembre 1981, tentant de mettre fin à des scandales avérés, et, surtout et enfin, la loi du 3 Septembre 2007, à l’initiative du président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi et grâce aux efforts de son futur Premier ministre, Yahya Ould Ahmed Waghef. C’est ce texte incriminant toutes pratiques qu’on persiste, en dépit de nouvelles rédactions par le régime actuel, à ne pas respecter.