18:16
La Mauritanie n’est pas un État d’apartheid
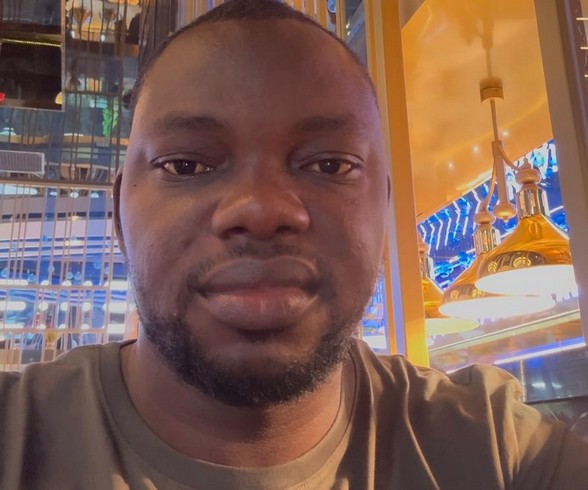
Brahim Korera -- La Mauritanie traverse des injustices et des inégalités, mais la qualifier d’“apartheid” est juridiquement et historiquement incorrect. L’apartheid sud-africain, instauré officiellement en 1948 par le Parti national sous Daniel François Malan, était un système légalement codifié de ségrégation raciale. Les lois majeures incluaient :
Le Population Registration Act (1950), qui classait chaque citoyen selon sa race et définissait strictement ses droits civiques et sociaux ;
Le Prohibition of Mixed Marriages Act (1949), interdisant tout mariage entre Blancs et non-Blancs ;
Le Bantu Education Act (1953), qui instaurait un système scolaire séparé et volontairement inférieur pour les Noirs, destiné à les préparer à des emplois subalternes ;
Le Group Areas Act (1950), qui contraignait les populations non-Blanches à vivre dans des zones spécifiques et réservait les villes et quartiers centraux aux Blancs.
Ces lois privèrent les Noirs de tout droit politique réel, les empêchèrent de se marier avec des Blancs, les reléguèrent à des zones résidentielles limitées et leur firent subir une éducation et des soins de santé inférieurs. La ségrégation était totale, systémique et institutionnalisée.
En Mauritanie, aucune législation n’interdit le mariage mixte, et Beïdanes et Noirs fréquentent les mêmes écoles et hôpitaux. Les discriminations sociales ou économiques qui existent ne sont ni systématiques ni codifiées pour établir une séparation raciale complète. Comparer notre pays à l’Afrique du Sud de l’apartheid est donc une erreur historique et juridique manifeste.
En outre , récemment, un citoyen mauritanien a fait un don substantiel à la population palestinienne. Cette initiative a suscité des critiques : certains ont estimé qu’il aurait dû prioriser sa région ou la lutte contre les injustices internes.
Certes, la Mauritanie connaît encore des inégalités et des discriminations, qui relèvent du droit international des droits humains et nécessitent une vigilance continue. Mais comparer cette situation à celle de la Palestine, où plus de 60 000 personnes ont été tuées en seulement deux ans, est réducteur et injuste.
La crise palestinienne dépasse frontières, races et régions : c’est une urgence humanitaire transnationale, encadrée par le droit international humanitaire, y compris les conventions de Genève sur la protection des civils. Aider ce peuple vulnérable ne diminue en rien notre responsabilité envers les Mauritaniens ; au contraire, c’est un acte conforme aux principes de solidarité internationale, de justice universelle et de responsabilité morale.
Plusieurs États ont reconnu l’État palestinien en 2025, et le président américain Donald Trump a engagé des efforts diplomatiques pour favoriser la paix entre Israël et la Palestine, protéger les civils et soutenir des solutions politiques durables.
Ces initiatives illustrent l’importance de la solidarité internationale et du respect du droit humanitaire. Critiquer ceux qui apportent leur aide dans ce contexte est non seulement regrettable, mais cela ignore la dimension juridique et morale de cette crise.
En un mot , la Mauritanie n’est pas un État d’apartheid. La solidarité envers le peuple palestinien n’affaiblit en rien notre responsabilité envers notre propre population. Reconnaître la souffrance des autres peuples tout en œuvrant pour résoudre nos propres injustices est ce qui définit véritablement l’humanité et la responsabilité morale d’un citoyen. Je remercie infiniment le président américain Donald Trump pour les efforts qu’il a déployés afin que ces deux États, l’État palestinien et l’État israélien, puissent vivre en paix.
May God protect the United States and Americans everywhere in the world.
Écrivain, Brahim Mamadou Korera
brahimkorera6@gmail.com