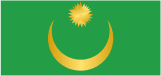28-03-2014 14:45 - Les producteurs de l'Histoire mauritanienne (5)

Adrar-Info - Hypothèses sur l’histoire, les sources et les historiens locaux.
Je vais avancer quelques hypothèses sur le problème général de l’histoire, des sources et des historiens locaux. Avant l’établissement des colonisations européennes, les sociétés sahariennes et sahéliennes ne produisaient pas un « récit continu d’événements vrais selon la durée » (Veyne 1971 : 103), c’est‐a‐ dire une Histoire historienne qui est un produit occidental, étroitement associé à l’idée grecque (énoncée par Thucydide, 395 Av. JC) que l’Histoire est le récit d’événements qui arrivent à une nation.
Or, « une fois l’Histoire devenue histoire d’un peuple, elle s’en tint là », mais les choses auraient pu aller autrement et ne pas, aboutir aux histoires nationales (Veyne 1971 : 103) ; hypothèse invraisemblable si l’on considère que les Etats nations européens émergèrent à la fin du XIXe siècle, et avec eux la nécessité de construire des histoires nationales.
Deuxièmement, il est évident que ces sociétés « voient la réalité exactement comme nous », avec des philosophies qui tentent de décrire et de justifier leur réalité et leur devenir ; qu’elles aient ou non l’écriture ne change rien à cette assertion qui contredit un peu l’hypothèse de Veyne sur les sociétés sans écriture.
Si j’avance cela, c’est parce que, comme on vient de le voir, le fait de disposer de l’écriture (arabe) n’a pas impliqué pour les Bidân sahariens un intérêt particulier à écrire leurs histoires, même locales. De même que les sociétés sahéliennes centralisées, connaissant l’écriture n’ont pas couché par écrit leurs complexes histoires dynastiques et ont préféré confier cette tâche aux spécialistes de la transmission orale, systématisée périodiquement selon des règles strictes, publiques et ésotériques — comme dans le cas de Waa Kamisòkò, décrit par P. F. de Moraes Farias, 2007.
À la lecture de ce qui précède, j’aimerais avancer que les Bidân, comme les autres peuples voisins, avaient une vision de leur devenir individuel et collectif qui n’était ni occidentale ni moderne, en ce sens qu’ils n’ont pas conçu une « Histoire des Bidân », ni donné une importance décisive à la vérité des faits.
En revanche, ils ont construit des récits locaux et régionaux dans lesquels ils mélangeaient, « le plus pacifiquement du monde », les récits d’événements censés avoir eu lieu et des idées mythiques et archétypales. Les Bidân n’ont pas montré du « désintérêt » pour ce que nous appelons Histoire politique, mais on peut avancer l’hypothèse, qu’en tant que peuple, ils ne considéraient pas que leur passé, leur présent et leur devenir puissent avoir de l’importance, ou une importance si grande qu’il soit nécessaire de l’écrire.
Ainsi, lorsque Miské (1970 : 88) s’étonne et se lamente du fait que l’auteur de AlWasît n’ait pas pu reconstituer « une synthèse historique plus globale des deux ou trois siècles » de l’histoire bidân, il nous communique un désarroi d’intellectuel occidental (ou occidentalisé, si l’on préfère). Position doublement étonnante pour nous, lorsqu’on constate que Miské (1970 : 87) lui même apportait la réponse à son propre questionnement lorsqu’il écrivait que les Bidân font remonter leur histoire (antique) à la période de l’islamisation (le XIe siècle) et que le reste rejoint « la grande Histoire », la vraie, celle du Prophète et des khalifes orthodoxes.
En conséquence, les histoires locales et régionales des Bidân ont concerné seulement des calendriers chronologiques, suivant un modèle pas particulièrement éloigné de l’ancienne manière de faire de l’Histoire occidentale, qui étudiait exclusivement, comme le note Veyne (1971 : 31), « les bons gros événements, faisant de “l’histoire‐traites‐batailles” ». Une perspective transformée en France par l’École des Annales qui a promu l’étude du non événementiel, non pas attachée « au temps‐qui‐passe » mais aux thèmes socialement pertinents (les femmes, l’amour, la mort, le pouvoir politique…).
La véritable Histoire pour les Bidân est donc l’histoire de l’islam, la seule qui mérite des textes écrits. Ils se rapprochent en cela, on peut le suggérer, des Hindous qui, comme le note Veyne (1971 : 101), ont préféré s’intéresser plutôt à « l’éternel ». La double distinction entre l’Histoire de l’islam et les histoires des groupes de parenté, et entre l’écrit et l’oral, a conduit à une disjonction hiérarchique : entre, d’une part, les spécialistes de l’écrit, les érudits religieux qui écrivent sur l’islam mais aussi parfois sur les groupes de parenté, avec une parole d’autorité revendiquée ; et d’autre part, les spécialistes de l’oralité, les bardes, qui narrent les histoires locales mais aussi les manières de vivre et les valeurs d’autrefois.
Ces fonctions sociales remplies par les bardes bidân sont assez semblables à celles remplies par les bardes sahéliens, avec une complexité des traditions dynastiques plus grande pour ces derniers. Cependant, malgré l’importance de ces fonctions pour l’ensemble de la société, elles ne sont pas socialement valorisées ni chez les Bidân, ni dans les sociétés sahéliennes mandé (Soninké et Mandenka), wolof et halpular’en (Tukolor et Fulbe). Ce sont les érudits des groupes religieux qui concentrent en effet l’essentiel de la parole d’autorité légitimée sur ce qu’on peut dire ou non du passé.
L’histoire fabriquée par les auteurs coloniaux : l’invention d’une histoire totale
La colonisation française a introduit des idées tout à fait nouvelles sur ce qu’est l’histoire des peuples, fondées de près ou de loin sur la vieille historiographie européenne de l’histoire des traites‐batailles citée par Veyne. Les attitudes et les pratiques politiques coloniales variaient selon les systèmes politiques locaux et la place occupée par l’histoire. Ainsi, dans les sociétés sahéliennes centralisées, avec des pouvoirs politiques complexes et des histoires orales ou écrites organisées, les administrateurs ont pu prendre connaissance rapidement du passé dynastique et ont pu également s’immiscer plus facilement dans les luttes politiques pour le pouvoir.
L’un des cas les mieux connus de ce type de processus est celui des royaumes wolof qui eurent à affronter l’immixtion directe des Français dans leurs luttes de succession dès le milieu du XIXe siècle (Searing 2007b). La situation était fort différente dans les sociétés sahariennes qui n’avaient pas de systèmes politiques centralisés, ni un passé historique organisé en un discours unifié.
Ici, les administrateurs ont mis longtemps à connaître non seulement l’étendue géographique du pays habité par les nomades, dont les Bidân et les Tuareg, mais surtout à comprendre un tant soit peu leurs systèmes politiques et sociaux, ainsi que leur passé collectif. Il est évident que les manières de penser ce passé n’étaient pas du tout les mêmes s’agissant des Sahariens, des Sahéliens et des Français. L’utilisation du terme « histoire » a suscité ainsi des malentendus tenaces, tout comme les termes reliés à l’autorité politique (rois, émirs, chefs) examinés par Taylor.
Les colonisateurs français considéraient que l’histoire des peuples, leur histoire politique s’entend, était une donnée naturelle, déjà là, prête à être connue ou découverte. Les peuples en question avaient leurs idées sur le passé mais elles ne correspondaient pas à celles des Français. L’idée historienne de l’histoire était une grande nouveauté en Afrique, qui fut introduite par les colonisateurs européens. L’idéologie coloniale qui alimentait la production historique des auteurs coloniaux se fondait sur des choix dans lesquels la chronique événementielle, la recherche des origines et l’attachement aux histoires dynastiques étaient fondamentaux.
De plus, en suivant la même logique d’enregistrement des groupes sociaux selon les classements coloniaux de « races », d’ethnies et de tribus, destinée à fixer définitivement les appartenances sociales des « indigènes », les auteurs coloniaux s’attachèrent à fixer les faits d’histoire des peuples en voie de conquête. Cette oeuvre coloniale de fixation rigide des événements historiques, souvent mal compris et mal interprétés, laissera de traces importantes chez des auteurs contemporains qui n’arrivent pas à se dégager de l’influence de la pensée coloniale française — et européenne en général.
À l’arrière plan de ces reconstructions historiques partisanes, on trouvait des thèmes idéologiques progressivement banalisés au cours du XIXe siècle, dont l’idée d’une hiérarchie des « races », le racisme et l’impérialisme européen. Comme je le montrais précédemment [Villasante Cervello 2007a, supra], le Gouverneur Général de l’AOF William Ponty (m. 1915), proposa sa « politique des races » au nom de la défense des idées de justice, de libéralisme, de stabilité politique, du progrès matériel, et dans le dessein d’annihiler les aristocraties africaines antérieures à la présence coloniale.
De son côté, l’administrateur Paul Marty (1916 : 7) commente cette politique des races de Ponty, qu’il admire énormément, en laissant transparaître des idées assez méprisantes à l’égard des Africains et remplies d’arrogance vis‐à-vis de l’œuvre « civilisatrice » de la France : « Dans ces groupements arbitrairement créés par la tyrannie des chefs locaux ou par la folie sanguinaire des conquérants et des marabouts, dans ces groupements artificiels que nous avions eu quelquefois la faiblesse de maintenir, il a rendu la main à tous les éléments ethniques, il a proclamé l’égale valeur humaine de tous les peuples et leur droit à l’existence.
Il a ramené à la vie des races qui se mouraient sous les oppressions sociales et religieuses, et l’on a eu la surprise de voir reverdir, croître et se révéler, pleins d’allant et d’espérance, des peuples qui semblaient à l’agonie. Cette politique des races n’est‐elle pas un dérivé de ce principe des nationalités qui triomphe aujourd’hui avec les armées de la civilisation ? ». (C’est moi qui souligne). Dans le même texte, Marty aborde la nouvelle « politique indigène » de contrôle colonial des chefs locaux, assez proche à l’indirect rule des Anglais, qui devait accompagner la politique des races : « La politique des races avait pour corollaire logique : l’utilisation des chefs locaux dans la mesure où ils peuvent être utiles à l’administration et aux administrés, et le contact permanent de l’autorité avec les indigènes. (…)
On saisit sa pensée dominante [celle de Ponty] : ce n’est pas la suppression des grands commandements, ni l’annihilation de l’autorité indigène, mais l’adaptation de notre administration aux contingences locales : commandement par les grands chefs quand les traditions y tendent et que les familles princières nous ont donné assez de preuves de leur loyalisme ; commandement par des chefs de canton dans des régions où l’enchevêtrement des races exige une certaine décentralisation ; commandement même par les chefs de village : autorité dispersée, s’il s’en fut, mais absolument nécessaire dans certaines peuplades anarchiques qui n’ont jamais connu de pouvoir constitué.
Pas de méthode rigide et cassante, pas de parti pris, toujours du tact, toujours de la conciliation, toujours de la bienveillance. » (Marty 1916 : 7‐8). (C’est moi qui souligne). En fait, toutes les administrations coloniales européennes ont appliqué, selon les situations et les stratégies en cours, des systèmes de contrôle politique direct ou indirect des populations africaines colonisées, en s’adaptant, comme le dit Marty, aux « contingences locales ».
Le grand changement introduit par les colonisations en Afrique fut la création d’un pouvoir centralisé étranger et extérieur aux sociétés africaines. Dans ce processus, les systèmes politiques locaux ont été profondément transformés par l’imposition d’un pouvoir politique colonial, et ce n’est pas parce que l’on a conservé parfois les mêmes appellations de « chefferie coutumières » qu’elles désignent une réalité ancienne ou immuable, comme on le pense souvent. Il faut comprendre que les administrateurs européens avaient une vision occidentale de l’autorité et accordaient aux « chefs », aux « rois » et autres « émirs », des attributions politiques et de concentration du pouvoir suprême très éloignés des pratiques et des idéologies politiques locales [Taylor 2007a].
En réalité, contrairement à la vision coloniale du commandement, les chefs ne gouvernaient jamais seuls mais toujours en étroite relation avec leurs formations politiques, leurs alliés et leurs partisans. Dans ce sens, ils étaient des représentants des intérêts des factions ou des coalitions formées pour les soutenir et celles‐ci pouvaient leur enlever la charge de commandement selon leurs objectifs politiques du moment. Les colonisateurs transformèrent cette situation, rapidement schématisée ici, en participant aux jeux factionnels, en accordant ou en refusant leur soutien à tel ou tel chef local, mais aussi en donnant le titre de « chef » à des hommes qui étaient jusque‐là exclus du système politique local.
Les nouvelles chefferies fabriquées par les colonisateurs ont pu conserver les nominations anciennes, mais elles n’étaient plus ce qu’elles étaient jadis. Du reste, le « loyalisme » des familles princières évoqué par Marty sera récompensé à la veille des indépendances par l’attribution de pouvoirs étendus aux membres les plus occidentalisés de telles familles. Je reviens sur cette question de la chefferie locale dans ma contribution sur la situation contemporaine de la Mauritanie [Villasante Cervello 2007c, infra].
L’historiographie coloniale en Mauritanie : Georges Poulet, René Basset et Paul Marty
L’objectif central des auteurs coloniaux travaillant en Mauritanie était de construire une « histoire totale » des « origines à nos jours », vaste entreprise en vogue au XIXe siècle et qui non seulement « trompe à son insu le lecteur sur la marchandise », mais représente également un « non sens qui relève de l’illusion dogmatique » (Veyne 1971 : 38). Il semble en effet insensé de prétendre que l’on puisse rédiger des textes qui reflètent l’histoire globale d’une société. Cela suppose qu’il existe un lien naturel entre les événements et les relations qui les unissent et qu’il faudrait juste les relever par écrit.
C’est bien évidemment l’historien qui choisit quels sont les liens pertinents entre les événements, en faisant un découpage dans la réalité pour construire son histoire (Veyne 1971 : 52, c’est moi qui souligne). Ainsi, contrairement à la croyance commune des auteurs du XIXe siècle, les événements ne sont pas neutres ; ils ne sont pas là, dans la réalité, prêts à être identifiés et consignés par écrit ou par l’observation. Cela veut dire que la fabrication de l’histoire est une entreprise largement subjective, ce que n’implique pas qu’elle soit arbitraire.
En effet, « on ne décrit pas dans l’absolu, toute description implique le choix, inconscient le plus souvent, des traits qui sont décrétés pertinents » ; dans ce cadre, disons‐le encore une fois, la chronique des événements ou, dans un autre langage, l’histoire traites‐batailles chère aux auteurs coloniaux « n’est pas la seule manière de faire l’histoire, elle n’en est même pas une pièce indispensable… elle est plutôt une solution de paresse. » (Veyne 1971 : 60).
Deuxième remarque générale, contrairement à une certaine vision des choses, selon laquelle les auteurs coloniaux peuvent être considérés comme des « ancêtres » des historiens, voire des anthropologues modernes, je soutiendrai ici qu’il n’en est rien. Cela reflète une vision étroite et simpliste du savoir ethnographique et une confusion tendancieuse entre savoir anthropologique et savoir colonial, avec l’idée sous‐jacente répétée ad nauseam selon laquelle les racines de l’anthropologie seraient coloniales.
Le domaine anthropologique est un produit culturel occidental et, en conséquence, il a traversé diverses phases de construction. Or, c’est dans la dernière phase, postérieure à la Seconde Guerre mondiale, que se sont construits les paradigmes les plus cohérents et les plus complexes de ce savoir, non pas à l’époque coloniale [Villasante 2007a, supra]. L’historiographie coloniale de la Mauritanie arabophone a été particulièrement développée par trois auteurs : Georges Poulet, René Basset et Paul Marty.
Avec plus ou moins de succès, ils se sont attachés à l’identification de phases ou d’étapes de ce qu’ils considèrent comme l’histoire totale mauritanienne. En réalité, ils ont repris dans leurs grandes lignes les histoires locales des érudits de la gebla, le Sud‐ouest mauritanien dont nous avons parlé précédemment, des histoires qu’ils ont « complétées », si l’on peut dire, avec les informations et les théories de Ibn Khaldûn (qui venait d’être traduit en anglais et en français) sur les « bédouins maghrébins » du XIVe siècle.
Des morceaux choisis d’histoires exotiques « bédouines et musulmanes » que les auteurs coloniaux ont parachevés avec leurs propres idéologies de l’histoire totale. Pour les administrateurs de la Mauritanie, l’histoire qu’il importait de construire était celle des nomades arabophones, qu’ils baptisèrent du nom antique de « Maures » : les « habitants du Nord de l’Afrique » des Grecs et des Romains, devenus, après, les « musulmans berbères et arabes envahisseurs de l’Hispania » des Ibères.
Des nomades qui s’auto‐désignaient Bidân, terme dont le sens a bien moins de rapports avec sa racine arabe (B/D/N, blancheur) — reprise par la plupart d’auteurs — qu’avec un double sens ethnique (nous, les hommes qui parlons le hassâniyya, l’arabe ouest‐saharien) et statutaire (les hommes libres, par opposition aux groupes serviles). Pourquoi avoir choisi de privilégier un accord parfait entre « l’histoire de Mauritanie » et « l’histoire des Maures » ?
Probablement parce que les auteurs coloniaux considéraient que les « Maures » étaient « l’ethnie majoritaire » dans l’espace compris entre le Sud marocain et algérien et le Nord du Fleuve Sénégal, ce en quoi ils n’avaient pas complètement tort. L’assertion est importante dans la mesure où la présence historique des « minorités » africaines wolof, halpular’en et soninké dans cet espace « mauritanien », inventé de toutes pièces par la colonisation française, allait poser des problèmes politiques non encore résolus de nos jours, mais qui vont bien au‐delà d’une vision simpliste et réductrice défendue par certains auteurs (i.e. Robinson 2000 : 79, Bonte 2000b) d’opposition « raciale » entre « Blancs et Noirs » qui auraient caractérisé les « luttes ethniques » récentes (Stewart 1989, Villasante Cervello 2001, 2003a).
A suivre …./
Mariella Villasante Cervello : »Les producteurs de l’histoire mauritanienne. Malheurs de l’influence coloniale dans la reconstruction du passé des sociétés sahélo-sahariennes », in Colonisations et héritages actuels au Sahara et au Sahel. Problèmes conceptuels, état des lieux et nouvelles perspectives de recherche (XVIIIeXXe siècles), M. Villasante (dir.), Vol 1, 2007 : 67-131.