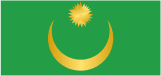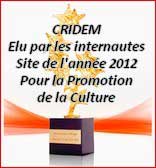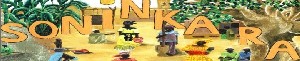19-04-2020 07:45 - La dette africaine envers la Chine et sa part d'opacité

RFI Afrique -
Mercredi 15 avril, Pékin a accepté, avec les autres pays du G20, de geler, pour une année, une partie de la dette de 77 pays dont une quarantaine de pays africains.
Un moratoire donc et non pas une annulation de créances. En la matière, rien ne pourra se faire sans l’avis de Pékin, premier créancier de l’Afrique.
Depuis quelques années, les grands argentiers de la planète, Banque mondiale et FMI en tête, accusent Pékin de ré-endetter, voire de sur-endetter l’Afrique.
Outre le fait que ces accusations rendent peu justice aux dirigeants africains - implicitement accusés de ne pas savoir gérer leurs affaires - elles ne correspondent qu’en partie à la réalité, tant la situation est différente d’un pays à l’autre.
À titre d’exemple, si 72% de la dette publique kényane est détenue par la Chine, cette dette n’a pas les mêmes effets sur un pays à l’économie dynamique, apte à produire des richesses, que sur Djibouti, endetté à 82% auprès de la Chine et dont l’économie se résume essentiellement aux activités portuaires.
L’opacité est encore trop souvent de mise
L’un des grands problèmes concernant la dette chinoise a trait à l’opacité des dirigeants de l’empire du Milieu, puisqu’ils ne rendent pas publics les détails de leurs opérations. Ainsi, il n’existe pas à l’heure actuelle de chiffre précis de cette dette mais seulement une estimation : entre 145 et 170 milliards de dollars pour un stock total de dette africaine estimé à 365 milliards de dollars.
La China Africa Research Initiative (Cari), institut de recherche dépendant de l’université américaine John Hopkins, a fait le calcul qu’entre 2000 et 2018, la Chine avait effectué plus d’un millier de prêts à 49 pays africains, pour une valeur de 152 milliards de dollars. À elle seule, l’Angola a reçu 43 milliards de dollars dont une partie gagée sur le pétrole. Depuis, Luanda aurait remboursé environ 16 milliards de dollars.
Ce qui rend les calculs plus difficiles, c’est aussi le fait que les chiffres annoncés ne sont pas toujours suivis d’effets. Ainsi, en 2017, la Chine claironne vouloir prêter au Nigeria 5,3 milliards de dollars mais seuls 2,5 milliards ont été réellement déboursés, selon la Cari.
L’opacité chinoise concerne aussi le fonctionnement des institutions prêteuses. Si l’Eximbank chinoise détient la majorité des créances, de nombreux prêts sont effectués par d’autres organismes, comme la Banque chinoise de développement ou encore de grandes sociétés de construction ou de travaux publics, des dizaines d’acteurs qui rendent difficile la compilation des chiffres.
Le même flou entoure parfois les conditions auxquelles l’argent est prêté. Certains dirigeants se satisfont de cette opacité, comme au Congo Brazzaville qui a longtemps caché au FMI le montant de sa dette chinoise. Il a fallu que l'institution internationale exige de Pékin un accord sur la restructuration de cette créance - qui pesait près de 40% de la dette globale du pays - pour donner son aval à un programme d’assistance à Brazzaville, alors en quasi-banqueroute.
L’une des difficultés avec les emprunts auprès de la Chine, c’est qu’ils mélangent parfois des investissements directs et des prêts concessionnels, comme le relevait, en 2015, l’économiste Sanou Mbaye, dans les colonnes du Monde diplomatique. Il est dès lors plus difficile de savoir ce qui relève de la dette et de l’aide. Globalement, la plupart des crédits accordés par Pékin sont des prêts concessionnels à taux avantageux mais les sociétés chinoises qui sont, elles aussi, créancières ont tendance à pratiquer des taux nettement plus élevés, associés à des délais de remboursement plus courts.
La mauvaise pratique des prêts gagés
La question qui agite les esprits concerne les prêts gagés, c’est-à-dire les remboursements en nature, lorsque l’emprunteur est jugé peu solvable. Un tiers des prêts chinois sont garantis, c’est-à-dire gagés sur des ressources ou des infrastructures.
Les Chinois n’ont pas le monopole de cette pratique, habituelle pour certaines compagnies pétrolières occidentales. Mais il a été souvent fait, à Pékin, le reproche « d’institutionnaliser » cette tendance. Ainsi, aujourd’hui, 63% du pétrole extrait en Angola sert à rembourser les prêts chinois.
L’abus de prêts gagés fait parfois grincer des dents les institutions financières internationales, comme ce fût le cas en République démocratique du Congo (RDC) en 2007. À l’époque, la Chine avait accordé pour 8,8 milliards de dollars de prêts à Kinshasa, en échange de l’exploitation de mines de cuivre et de cobalt ainsi que de la construction d’infrastructures de base. Ce troc avait fait réagir le FMI qui en dénonçait l’opacité.
Si l’appétit chinois pour les matières premières n’est plus à démontrer, Pékin n’est pas forcément le prédateur que certains de ses concurrents dépeignent. Ses prêts favorisent aussi le développement d’infrastructures qui justement permettent aux États d’exploiter leurs ressources. Ainsi, la Cari a calculé que 40% des prêts accordés par la Chine a servi à payer la construction d’unités de production et de distribution d’électricité, et 30% à des infrastructures de transport (des routes, des ports et des trains).
Il reste qu’aujourd’hui, alors que le niveau moyen d’endettement des pays africains a doublé en dix ans pour remonter à 60 % du PIB, huit pays africains sont surendettés et une dizaine d’autres pourraient se retrouver rapidement dans cette situation, d’après le Fonds monétaire international.
Des prêts en baisse
Désormais Pékin se montre plus prudent avec certains de ses partenaires. La Cari affirme d’ailleurs que les prêts chinois ont même commencé à diminuer, à partir de 2013.
Pékin deviendrait aussi plus regardant sur la qualité des projets et leur solvabilité. Le rapprochement avec le Club de Paris, qui regroupe les créanciers publics des États africains et où la Chine à désormais une place d’observateur, participe à ce mouvement.
Si le géant chinois n’en est pas encore à rejoindre les standards occidentaux en matière de prêts, il commence cependant à s’en approcher. Il est d’ailleurs à parier que la pandémie de Covid-19 et la crise économique mondiale qui en découle pourraient renforcer cette tendance.
Texte par :
Olivier Rogez