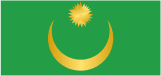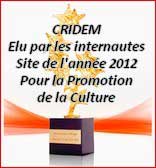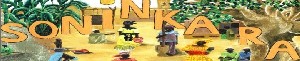11-06-2020 00:34 - Connaissez-vous Peter Zeihan ? ou l’avènement de la Mauritanie Gazière
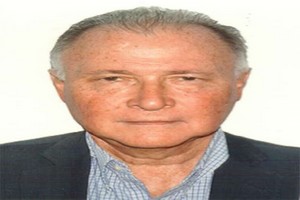
Jean Marie Guichaoua - C’est un penseur géostratégique américain peu connu dans la francophonie qui, depuis 2010, communique sur la fin de la mondialisation et ses conséquences.
Rappelez-vous. À la fin de a première guerre du golfe (1991) l’omnipotence américaine était unanimement reconnue. Un penseur américain de l’époque, Francis Fukuyama, avait ressorti le concept de « la fin de l’histoire », pour signifier que le monde aller désormais fonctionner sous la « pax americana », sans conflit ni contestation. Belle histoire !
Les événements ont toujours raison des fins de l’histoire et Peter Zeihan prend l’exact contre-pied avec 3 ouvrages non traduits jusqu’à ce jour (j’en traduis les titres et sous titres pour cet article) :
• Superpuissance accidentelle en 2014 ou la nouvelle génération de la prééminence américaine et le désordre mondial à venir.
• Superpuissance absente en 2017 ou la révolution du schiste et un monde sans l’Amérique.
• Les Nations Désunies en 2020 ou la lutte pour le pouvoir dans un monde non régulé.
Les sous-titres indiquent la tendance de sa pensée mais celle-ci est réellement explosive et explicative du monde du début du XXI° siècle.
L’abolition des Empires à la fin de la II° guerre mondiale (anglais, français, nééerlandais, portugais) et la rivalité avec l’Union Soviétique, ont fait germer une stratégie géopolitique américaine : le libre accès aux ressources mondiales pour tous. Ce que nous avons considéré comme un effet historique de l’Après-guerre était en fait une arme de guerre à l’encontre de l’Union soviétique.
Rendre les marchés et les ressources accessibles à tous supposait la sécurité des mers et c’est ce à quoi s’emploie la marine américaine depuis la fin du XX° siècle. Les océans sont sûrs et le commerce international devient accessible à des puissances moyennes. Le modèle libéral pouvait se déployer à moindre coût (coût supporté par la superpuissance) et générer la prospérité dans la plupart des pays à la désolation des pays du bloc soviétique.
L’effondrement du modèle soviétique dans les années 90, et le revirement au libéralisme des ex-pays communistes, Chine comprise, a constitué une première remise en question de la justification de l’entretien des coûts de la superpuissance. Cette remise en question est passée inaperçue par l’action du lobby politico-militaire américain et par la nécessité de réguler le marché du pétrole, seul lien véritable américain avec le commerce international.
Toutefois l’idée a fait son chemin, que sans la présence massive de la marine américaine, le commerce international et la mondialisation exacerbée du début du XXI° siècle, s’effondreraient. C’est le sens du premier ouvrage de Peter Zeihan, qui sort à la première élection de Barack Obama, mondialiste convaincu.
Le second élément destructeur de la justification de la politique de superpuissance est le développement de l’exploitation des gaz de schiste aux Etats-Unis. Pour la première fois depuis les années 1930, les Etats-Unis sont autosuffisants en pétrole. La protection des importations de pétrole étaient le seul intérêt restant pour assurer la sécurité des océans. C’est le sens du deuxième ouvrage de Peter Zeihan dont le sous-titre est explicite : la révolution du schiste et un monde sans l’Amérique. La date de sortie du livre, en 2017, n’est pas anodine : c’est l’année de l’élection de Donald Trump.
Certains commencent à grincer des dents en comprenant que les postures du Président américain ne sont pas que l’effet de lubies médiatiques, mais le résultat de l’évolution d’une pensée construite sur le désengagement américain de la sécurité du monde.
Le troisième ouvrage de Peter Zeihan date de cette année et tire la conséquence des deux premiers. La sécurité des océans a permis l’essor phénoménal de la mondialisation. Son coût était justifié par la lutte anti-soviétique : il ne l’est moins depuis la fin du XX° siècle. Il ne l’est plus du tout avec l’autonomie énergétique nouvelle des Etats-Unis. Conclusion : les Etats-Unis vont cesser d’assurer la sécurité des océans ce qui aura pour conséquence la fin de la régulation de la mondialisation. Rien de moins.
La pensée de Peter Zeihan est explosive car pour la quasi-totalité des intellectuels occidentaux, la mondialisation, qu’on l’aime ou qu’on la déteste, était une tendance lourde de l’histoire avec laquelle on devait vivre avec. On découvre que cette organisation du monde (délocalisations, aménagements structurels, politiques d’austérité, paupérisation, FMI, Banque Mondiale etc…) ne repose que sur l’engagement de flotte américaine et son retrait est quasi inéluctable. D’où les grandes manœuvres auxquelles on assiste parmi les candidats au leadership (Chine, Russie, Turquie…) notamment avec la Route de la soie. C’est le sens du sous-titre de l’ouvrage : la lutte pour le pouvoir dans un monde non régulé.
Cet article n’a pas que la seule ambition modeste de faire connaître un penseur méconnu des francophones ; il doit faire réfléchir à ce qu’un pays comme la Mauritanie subirait comme conséquences en cas de contraction (ou renchérissement majeur) du commerce international.
Dépendant à 99% du commerce international, pour ses importations et ses exportations, la Mauritanie a de quoi se faire du souci dans l’hypothèse de la fin de la mondialisation. Ses hommes d’affaires cultivent le modèle du négoce à tous les stades de l’activité économique, et ce modèle a de grandes chances de s’effondrer. Si on divise les « époques » de la Mauritanie depuis 1958, en :
• Epoque de l’indépendance (1960-1978)
• Epoque militaire (1978-2019),
on constate un retrait constant des projets de développement. Les ambitions d’industrialisation des années de l’Indépendance, ont laissé place à l’époque militaire à la mise en place de la mondialisation (ajustements structurels) et aux importations massives allant dans le sens des tendances décrites par Peter Zeihan. Aujourd’hui on veut faire machine arrière avec l’espoir de retrouver d’autosuffisance mais c’est toute la carapace des structures des opérateurs en place orientés sur le négoce qui sclérose le changement.
Ce qu’apporte la pensée de Peter Zeihan, c’est l’alerte que le modèle du négoce pour la Mauritanie est en voie de pulvérisation : que faire si on ne peut plus importer de riz, de blé, de sucre ; que faire si on ne peut plus exporter de fer, de cuivre ? Les activités de transformations sont plus que jamais indispensables même si cela doit passer par une révolution culturelle chez les hommes d’affaires.
Par chance la Mauritanie dispose de réserves de gaz, et un d’un projet d’exploitation imminent, qui pourraient théoriquement assurer l’industrialisation rêvée à l’Indépendance. De plus l’entrée probable dans la CDEAO ouvre un marché digne de ce nom aux investissements. C’est pourquoi le pays entre dans l’époque de la Mauritanie « gazière » où l’autonomie (rendue possible contrairement aux autres époques), sera le concept clé de l’économie du pays, comme des pays qui surnageront à la dérégulation imminente de la mondialisation.
Jean-Marie Guichaoua. Mars 2020.
Sciences Po Paris 1976, consultant en Mauritanie.
Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité.