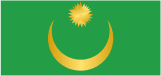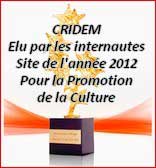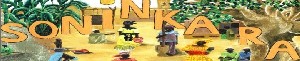02-11-2025 07:45 - Sauver le Mali, c'est sauver la sous-région / Par Thierno Alassane Sall, Député à l'Assemblée nationale du Sénégal

PRESSAFRIK -
J'avais rappelé du haut de la tribune de l'Assemblée nationale du Sénégal, lorsque la CEDEAO envisageait une intervention militaire au Niger, l'urgence à maintenir des voies de communication avec les juntes.
Mais, en dehors d'un régime drastique de sanctions, la communauté internationale s'est laissé enfermer dans le piège tendu par les juntes de l'AES, soutenues par des opinions chauffées à blanc parce que meurtries et humiliées par la fulgurance des avancées des rébellions, juntes qui ne souhaitaient rien de tel qu'un huis clos avec leurs oppositions.
Ce fut la faute la plus grave de la CEDEAO, qui a entraîné le reste de la communauté internationale à se laver les mains du sort des États de l'AES, comme si des cataclysmes dans ces pays ne manqueraient pas d'avoir des répercussions désastreuses dans toute la sous-région et au-delà.
Au regard des derniers développements au Mali, l'optimisme peut amener à croire qu'il n'est pas trop tard. Mais alors, il s'agit d'agir vite. En effet, la situation qui semble guetter le Mali frère impose d'entreprendre des actions concertées, au niveau régional, au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine, mais aussi au plan international. Le régime actuel du Mali semble avoir épuisé toutes ses cartouches. Wagner puis son clone se sont apparemment évaporés. Le siège de la junte, la ville garnison de Kati, est incapable de sécuriser ses abords, jusqu'où le JNIM vient s'emparer des camions-citernes.
C'est dire s'il est urgent de prendre des initiatives.
À ce titre, le régime en place au Sénégal, plus que tout autre, a l'obligation d'agir. Nous sommes tout près de l'épicentre du cataclysme.
Les villages tombent les uns après les autres, les populations fuient, et les chancelleries occidentales appellent leurs ressortissants à quitter le Mali.
Lorsqu'elles ordonnent une évacuation, on peut y voir un signe avant-coureur, conforté par la réalité du terrain. L'armée malienne semble aujourd'hui débordée, peinant même à sécuriser l'approvisionnement vital en carburant de Bamako. La tactique du JNIM est limpide, même aux profanes dans l'art de la guerre mettre le Mali en panne sèche, sans électricité, sans approvisionnement en denrées de première nécessité puisque sans carburant pour faire tourner les centrales et les camions.
Comme d'autres localités qui avaient expérimenté le blocus auparavant, ce sont les populations qui finiront par demander de négocier.
Pour l'heure, comme tout au long de cette longue tragédie, la propagande aux airs souverainistes voudra mettre l'alerte des pays occidentaux au compte d'un complot ourdi par ces puissances. Hélas, ces puissances, grâce à leurs moyens de renseignement électronique (satellites, drones, écoutes téléphoniques) et à leurs réseaux de terrain, en savent souvent plus que les concernés.
Elles sont déjà vraisemblablement en contact avec les djihadistes, pour ne pas insulter l'avenir. L'exemple récent de la Syrie devrait être médité.
De leur côté, nos États ne peuvent pas attendre que Bamako tombe comme un fruit mûr : le blocus se resserre déjà autour de Nioro et de Kayes. Si le Mali venait à tomber entre les mains des rebelles, ce seraient des factions djihadistes rivales qui s'affronteraient dans des guerres interminables. La contagion à d'autres pays de la sous-région serait difficile à éviter, en tout cas au prix d'un virage sécuritaire qui ruinerait toute perspective de développement économique pour des décennies.
Au-delà, des pays aux économies exsangues et aux infrastructures dérisoires devront faire face à des flots de réfugiés. En sus d'être exposé immédiatement et directement à ces conséquences, le Sénégal risque de subir un choc économique, étant à la fois le principal port du Mali et un de ses partenaires commerciaux de premier plan.
Au-delà de ces considérations matérielles, nous partageons avec le Mali ce que seule la blessure coloniale a séparé. Cette vérité intangible est rappelée par nos devises nationales communes: un peuple, un but, une foi.
Si ces devises ne sont pas que des mots, mais une foi comme elles le clament, alors, en dépit de l'enfermement psychologique du régime en uniforme des forces spéciales de Bamako, le Sénégal doit prendre l'initiative.
Hélas, la tragédie que nous vivons ne serait pas totale si, à Dakar également, ne régnait un régime aux tendances despotiques profondes. Comme au Mali, l'ennemi principal n'est pas celui qui menace à nos frontières, mais les supposés "résidus" internes et les adversaires de parti, voire... des ministres d'un même gouvernement.
Alors que le JNIM campe autour de Nioro et de Kayes, à Bamako on condamne l'ancien Premier ministre Moussa Mara pour avoir donné son opinion sur la situation du pays. Dernier clou dans le cercueil de la démocratie malienne que la junte a étouffée au nom de la sécurité nationale. Et quand le JNIM arrive dans les faubourgs de Bamako, il trouve une société dont les forces vives ont été étouffées par une junte assoiffée de pouvoir, une société civile vidée de sa sève, des opposants en prison ou en exil. Bref, le Mali est un fruit mûr, quoique fortement toxique, pour le JNIM.
C'est la même expérience que tente le régime Pastef au Sénégal, avec le même aveuglement qui lui fait oublier l'ennemi à nos frontières. On croit voir Néron jouer sa lyre dans Rome en flammes quand on entend des députés du Pastef réclamer du président Diomaye une démission promise à Ousmane Sonko au bout de six mois d'exercice du pouvoir. En violant sa promesse faite aux Sénégalais et le serment fait au Conseil constitutionnel ?
La disette qui frappe un grand nombre de Sénégalais, le chômage, les menaces d'épidémie, les difficultés financières, l'ennemi à nos frontières, les conséquences éventuelles d'un changement de régime à Bamako, rien de cela ne douche les ardeurs bellicistes de l'État Pastef. Entre deux échanges de tirs amis entre ministres d'un même gouvernement ou du Premier ministre vers le président, il trouve le temps de s'en prendre à la presse, aux chroniqueurs, aux opposants...
Cette coupable incompétence pourrait nous coûter cher. Le soutien populaire n'est en rien une garantie contre la décomposition provoquée par le virus de l'incurie, comme l'illustre de manière tragique le drame malien.
C'est dans des moments historiques singuliers que se révèlent les grands dirigeants où les piètres charlots qui moulinent des slogans, mais sont incapables d'actions. Rarement le Sénégal n'a été aussi exposé. Le théâtre où se joue le drame est toute la sous-région, notre territoire y compris. Pas l'enceinte d'un stade, ou plutôt d'un cirque.
Thierno Alassane Sall,
Député à l'Assemblée nationale du Sénégal