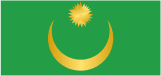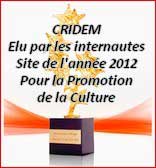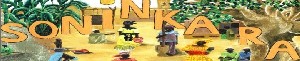29-04-2025 07:45 - Stratégies vitales d'ajustement pour Sidi Ould Tah : Analyse comparative des discours des candidats à la présidence de la BAD. Par Pr ELY Mustapha

Quels ajustements de stratégies Sidi Ould Tah devrait désormais adopter face aux autres candidats à quelques semaines de l’élection à la présidence de la BAD ?
Alors que l’élection à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD) approche, les cinq candidats affinent leurs arguments pour convaincre les 81 pays actionnaires. Sidi Ould Tah, candidat mauritanien, fait face à une concurrence structurée autour de visions contrastées. Cette analyse approfondie compare les discours des prétendants et identifie les leviers stratégiques pour optimiser sa campagne finale.
Depuis l’annonce de sa candidature à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD), Sidi Ould Tah a articulé une vision ambitieuse, structurée autour de plusieurs axes stratégiques. Ses interventions, marquées par un pragmatisme revendiqué et un ancrage dans son expérience à la tête de la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA), révèlent une approche à la fois technique et transformative. Cette analyse explore les thèmes récurrents, les innovations proposées et les défis soulevés par son discours politique.
Une vision structurée autour de quatre piliers fondamentaux
Mobilisation des capitaux et réforme de l’architecture financière
Le candidat mauritanien place la mobilisation des ressources financières au cœur de sa stratégie. Il propose un effet de levier inédit, visant à multiplier par dix l’impact de chaque dollar investi par la BAD. Cette ambition s’appuie sur un partenariat renforcé avec les actionnaires non régionaux, notamment les pays du Golfe, dont les fonds souverains détiennent des liquidités considérables. « Chaque dollar décaissé par la BAD doit correspondre à 10 dollars investis sur le terrain », affirme-t-il, soulignant la nécessité de transformer l’aide publique en investissements rentables.
Parallèlement, Ould Tah plaide pour une réforme de l’architecture financière africaine, en harmonisant les actions des institutions continentales comme la BAD, l’Africa Finance Corporation (AFC) et Afreximbank. Il critique l’absence de synergies entre ces entités, comparant la situation actuelle à une « orchestre sans chef ».
Son objectif : faire de la BAD un « agrégateur de ressources » capable de coordonner les efforts et d’éviter les doublons.
Transformation du dividende démographique en force économique
Face au boom démographique africain – un quart de la population mondiale sera africaine en 2050 -, Ould Tah insiste sur l’urgence de créer 20 millions d’emplois annuels. Sa solution repose sur un double mécanisme :
1. Le développement massif de la formation technique et professionnelle, adaptée aux besoins des marchés émergents.
2. La création d’une institution panafricaine de garantie pour faciliter l’accès au crédit des PME, notamment via des outils technologiques comme l’intelligence artificielle.
Il met en garde contre les risques d’inaction : « Si cette jeunesse reste sans travail, à la marge, c’est un risque pour l’Afrique et le monde ». Cette approche s’inscrit dans une logique de transition vers l’économie formelle, où le secteur privé jouerait un rôle central.
Industrialisation et valorisation des ressources naturelles
Ould Tah dénonce le paradoxe africain : détenteur de 30 % des réserves mondiales de minerais, le continent ne capte qu’une fraction de la valeur ajoutée. Son programme prévoit donc un virage industriel axé sur la transformation locale des matières premières. « L’enjeu n’est pas l’absence de ressources, mais leur valorisation », martèle-t-il, citant l’exemple des terres rares et des minerais critiques essentiels à la transition énergétique.
Ce projet s’accompagne d’un plan d’infrastructures ambitieux, visant à créer des corridors logistiques transcontinentaux. Pour lui, la réussite de la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf) dépend de la connectivité routière, ferroviaire et énergétique.
Modernisation de la gouvernance de la BAD
Critiquant les performances actuelles de la BAD – dont les approbations annuelles restent inférieures à celles de ses homologues asiatiques ou latino-américaines –, Ould Tah promet une revue complète des processus lors de ses 100 premiers jours. Il envisage une consultation élargie avec les actionnaires, la société civile et le secteur privé pour améliorer la transparence et l’efficacité.
Un discours ancré dans l’expérience de la BADEA
Capitalisation sur des résultats tangibles
Le candidat mauritanien brandit son bilan à la BADEA comme preuve de sa capacité à réformer les institutions multilatérales. Sous sa direction (2015-2025), le capital de la banque est passé de 4,2 à 20 milliards de dollars, tandis que les créances douteuses chutaient de 10 % à 0,5 %. Il met en avant le premier eurobond de 500 millions de dollars émis en 2024, présenté comme un modèle de mobilisation de capitaux internationaux.
Un leadership tourné vers les partenariats Sud-Sud
Son expérience à la BADEA a forgé une approche diplomatique originale, combinant relations avec le monde arabe et ancrage africain. Il a multiplié les cofinancements avec des partenaires du Golfe, mobilisant près de 2 milliards de dollars pour des projets d’infrastructures. Cette expertise pourrait, selon lui, aider la BAD à attirer les investisseurs souverains réticents face aux risques perçus en Afrique.
Les contradictions et défis du discours
Un pragmatisme technocratique face aux enjeux politiques
Si Ould Tah se présente en technocrate expérimenté, son discours évite soigneusement les sujets géopolitiques sensibles. Aucune mention claire n’est faite de la gestion des dettes souveraines ou des tensions entre régions africaines, pourtant cruciales pour la BAD. Cette prudence reflète peut-être la nécessité de ne pas froisser les États membres lors d’une campagne électorale complexe.
L’ambiguïté du positionnement régional
En tant que candidat d’un pays à cheval entre l’Afrique du Nord et l’Ouest, Ould Tah peine à mobiliser un bloc régional uni. Ses discours tentent de transcender cette division en insistant sur l’« unité africaine », mais ses soutiens affichés (Côte d’Ivoire, Tunisie, Congo-Brazzaville) restent épars géographiquement.
Le paradoxe de l’innovation financière
Alors qu’il promet des instruments financiers innovants, son expérience à la BADEA montre une prédominance des prêts classiques. Son discours sur les partenariats public-privé reste vague, sans détail sur les mécanismes de partage des risques.
Entre ambition réformatrice et réalisme politique
Les discours de Sidi Ould Tah dessinent le portrait d’un candidat technocrate, rompu aux arcanes des institutions financières multilatérales.
Sa force réside dans un programme structuré et des résultats tangibles à la BADEA. Toutefois, son évitement des questions politiques sensibles et sa dépendance aux partenariats externes soulèvent des interrogations sur sa capacité à impulser un changement radical à la BAD. Comme il le reconnaît lui-même : « L’Afrique n’a pas besoin de plus d’aide, mais de partenariats rentables ». Reste à savoir si cette vision suffira à convaincre les 81 pays actionnaires de la BAD, dont les intérêts divergent souvent. Et surtout s’il convainc par rapport aux autres candidats.
Quels ajustements devrait-il faire face aux discours des candidats pour « gagner sur leur terrain ».
Quels ajustements de stratégies Sidi Ould Tah devait désormais adopter face aux autres candidats ?
Alors que l’élection à la présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD) approche, les cinq candidats affinent leurs arguments pour convaincre les pays actionnaires. Sidi Ould Tah, candidat mauritanien, fait face à une concurrence structurée autour de visions contrastées. Cette analyse compare les discours des prétendants et identifie les leviers stratégiques pour optimiser sa campagne finale.
Analyse des visions concurrentes
1. Sidi Ould Tah : Pragmatisme financier et synergies institutionnelles
Sa campagne, rappelons-le, s’appuie sur quatre piliers : impact, innovation, inclusion et intégration. Il met en avant son bilan à la BADEA (comme on l’a mentionné : capital quintuplé à 20 milliards de dollars, premier eurobond de 500 millions de dollars émis en 2024) et propose :
• Un effet de levier financier visant à multiplier par dix l’impact des fonds de la BAD via des partenariats Sud-Sud.
• Une réforme des institutions financières africaines pour harmoniser les actions de la BAD, de l’Africa Finance Corporation (AFC) et d’Afreximbank.
• La création d’une institution panafricaine de garantie pour les PME, combinant intelligence artificielle et formation technique.
Points forts : Crédibilité technique, réseaux avec les fonds souverains du Golfe, ancrage géopolitique neutre entre Maghreb et Afrique de l’Ouest.
Points faibles : Silences sur la dette souveraine et l’inclusion genrée, risques éthiques liés à son maintien à la BADEA pendant la campagne (n’ayant pas démissionné pour faire campagne).
2. Amadou Hott (Sénégal) : Le privé comme moteur de développement
L’ancien vice-président de la BAD axe son discours sur :
- La mobilisation de capitaux privés, critiquant la dépendance aux financements publics.
- Des méga-projets d’infrastructures comme « Desert to Power » (énergie solaire au Sahel).
- Une gouvernance axée sur les résultats, avec une réduction de la bureaucratie.
Atouts : Expérience dans les montages financiers complexes, soutien de la Francophonie.
Risques : Perçu comme trop aligné sur les intérêts des investisseurs internationaux.
3. Samuel Munzele Maimbo (Zambie) : Exécution rapide et intégration régionale
Le candidat zambien, soutenu par la SADC et le COMESA, prône :
- Une BAD « implémentatrice », priorisant l’exécution de projets plutôt que de nouvelles stratégies.
- L’accélération de la Zlecaf via la suppression des barrières non tarifaires.
- Une mobilisation innovante des fonds africains (fonds de pension, banques centrales).
Forces : Expérience à la Banque mondiale, soutien régional solide.
Faiblesses : Maîtrise limitée du français, risque de dilution dans les priorités régionales.
4. Bajabulile Swazi Tshabalala (Afrique du Sud) : Inclusion et financements hybrides
Seule femme candidate, elle défend :
- Une BAD « inclusive » avec 40 % de financements dédiés aux projets féminins d’ici 2030.
- Des instruments financiers hybrides (dette-fonds propres) pour augmenter les capacités de prêt.
- Un fonds climatique panafricain aligné sur les Accords de Paris.
Atouts : Expérience en capital hybride à la BAD, soutien de Cyril Ramaphosa.
Défis : Concurrence régionale avec Maimbo, perçue comme héritière de l’équipe sortante.
5. Abbas Mahamat Tolli (Tchad) : Industrialisation et souveraineté économique
Le candidat de la CEEAC et de la CEMAC insiste sur :
- La transformation locale des matières premières pour créer des emplois.
- Le désenclavement de l’Afrique centrale via des corridors logistiques.
- Une réforme monétaire pour intégrer les devises africaines
Forces : Soutien unanime de l’Afrique centrale, expérience à la BEAC.
Faiblesses : Accusations passées de mauvaise gouvernance, focalisation régionale excessive
Avantages et angles morts de Sidi Ould Tah
Avantages distinctifs
• Crédibilité opérationnelle : Contrairement à Maimbo (plans théoriques) ou Tolli (promesses industrielles), Ould Tah présente un bilan vérifiable à la BADEA, avec un taux de créances douteuses réduits )
• Diplomatie financière : Ses partenariats avec les fonds souverains du Golfe (2 milliards de dollars mobilisés) répondent au besoin de diversification des sources de financement, un point faible de Hott et Tshabalala.
• Positionnement transrégional : Sa capacité à naviguer entre l’Afrique francophone, anglophone et arabophone le distingue de Tolli (Afrique centrale) ou Maimbo (Afrique australe).
Angles morts à corriger
1. Absence de feuille de route climatique : Alors que Tshabalala propose un fonds dédié et Hott mise sur l’énergie solaire, Ould Tah reste vague sur l’adaptation climatique, pourtant cruciale pour les pays sahéliens.
2. Silence sur l’inclusion genrée : Son discours sur les PME ignore la dimension genre, contrairement à Tshabalala qui vise 40 % de financements féminins.
3. Risque éthique persistant : Son maintien à la tête de la BADEA pendant la campagne contraste avec la démission de Tshabalala de la BAD en 2024, suscitant des doutes sur son impartialité.
Recommandations stratégiques pour les prochains discours
1. Incorporer une dimension climatique ambitieuse
- Proposition : Lancer un « Fonds solaire transsaharien » en partenariat avec la BADEA et l’Arabie saoudite, visant 10 GW d’énergie propre d’ici 2030.
- Justification : Répondre aux attentes des actionnaires non africains (États-Unis, UE) tout en capitalisant sur l’expertise de la BADEA en énergie renouvelable.
- Citation possible : « L’Afrique doit transformer son soleil en moteur de développement industriel ».
2. Adopter un discours inclusif et chiffré
- Engagement : Allouer 30 % des garanties de la BAD aux PME dirigées par des femmes, avec un mécanisme de mentorat technologique.
- Exemple concret : S’inspirer du Fonds BADEA de 200 millions de dollars pour l’entrepreneuriat féminin lancé en 2023.
- Message clé : « Aucune économie ne peut prospérer en excluant la moitié de ses talents ».
3. Lever les ambiguïtés éthiques
- Action : Publier un audit indépendant des dépenses de campagne et annoncer son départ anticipé de la BADEA en cas d’élection.
- Alliés : Mobiliser Frannie Leautier, ex-vice-présidente de la BAD, pour vanter son intégrité.
- Narrative : « La transparence n’est pas une option, c’est la condition sine qua non de la confiance ».
4. Affirmer une vision politique audacieuse
- Initiative : Proposer un « Mécanisme africain de restructuration de la dette » en partenariat avec le FMI, combinant rééchelonnement et investissements productifs.
- Cible : Rassurer les pays francophones surendettés (Côte d’Ivoire, Sénégal) tout en sécurisant le soutien des créanciers non africains.
- Discours : « La dette ne doit pas être une prison, mais un tremplin pour l’autonomie financière ».
Les clés d’une victoire stratégique.
Pour l’emporter, Sidi Ould Tah doit transformer ses atouts techniques en leadership politique. En hybridant les approches de ses concurrents – l’inclusion de Tshabalala, l’exécution de Maimbo, l’industrialisation de Tolli –, il peut incarner le compromis nécessaire entre pragmatisme financier et vision transformative.
Sa capacité à désamorcer les critiques éthiques et à articuler une réponse climatique crédible sera déterminante pour rallier les indécis. En répondant à cette attente, Ould Tah pourrait bien devenir le premier président sahélo-maghrébin de l’institution.
Pr ELY Mustapha