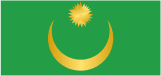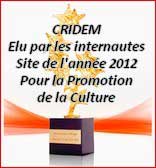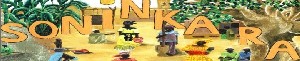16-10-2025 13:18 - M. Brahim Bilal Ramdane, président de la Fondation Sahel: "Le chemin vers un dialogue véritable est long et semé d’embûches"
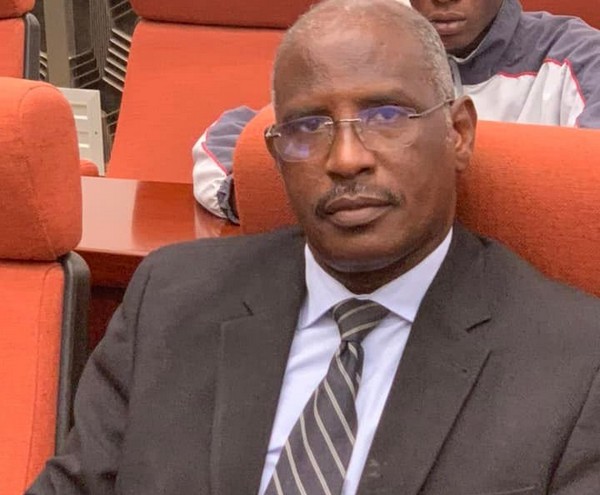
Le Calame -- Un débat sur l’identité des Hartanis a inondé les réseaux sociaux et quelques plateaux de télévision. Entre ceux qui estiment qu’il est nécessaire et ceux qui estiment que c’est un faux débat, où vous situez-vous ?
Brahim Bilal Ramdane : Je vous remercie de m’offrir cette tribune pour aborder des questions de nature existentielle pour notre Nation. Concernant le débat sur l’identité des Haratines, je me range résolument du côté de ceux qui le jugent non seulement pertinent mais indispensable. Nous émergeons des limbes de l’Histoire, porteurs d’une mémoire longtemps confisquée et nous avançons vers un avenir que certains redoutent mais que d’autres appellent de leurs vœux. Ce débat est vital pour deux raisons essentielles.
Premièrement, il s’agit d’un impératif d’auto-détermination : nous aspirons à être les architectes de notre propre identité et non le reflet passif des projections d’autrui. Comment pourrions-nous accepter que d’autres, souvent ceux-là mêmes qui ont contribué à l’effacement de nos origines, prétendent nous définir ? Confierions-nous notre avenir à ceux qui nient notre passé ? La quête identitaire est un acte d’émancipation, un rejet de toute tutelle symbolique.
Ce besoin d’identité n’est ni pour ni contre d’autres identités, c’est, tout simplement, la reconnaissance d’une commune traversée faite de souffrances et luttes, une marginalisation et une privation de la participation au partage national du pouvoir, du savoir, de l’avoir et une conscience d’un destin commun. Je ne vois pas en quoi on peut s’en offusquer.
Deuxièmement, émerger du néant, c’est revendiquer le droit à l’existence. Or, pour les Haratines, cette existence, en tant que composante politique autonome, exige une démarcation claire par rapport à une entité dont le lien originel n’est autre que l’asservissement. Cette relation, à mes yeux, est non seulement fragile mais infamante ; elle doit être transcendée par une affiliation choisie, digne et conforme à notre aspiration légitime à la reconnaissance. Certains, il est vrai, s’opposent à cette démarcation, par peur du changement ou par attachement à un ordre inique. Leur résistance ne fait que confirmer la nécessité de notre combat.
- Ce débat est intervenu à l’heure où des discours de haine extrêmement dangereux envahissent les réseaux sociaux, les plateaux de télévision et les manifestations. À votre avis, comment la Mauritanie en est-elle arrivée là ? À qui la faute ?
- Les discours haineux sont, en effet, moralement condamnables et socialement toxiques. Nul ne le conteste. Toutefois, ils ne tombent pas du ciel : il n’y a pas de fumée sans feu, ils sont le symptôme d’un mal plus profond, d’un racisme systémique qui, depuis l’époque de Maaouiya et même avant, a été érigé en mode de gouvernance.
L’État lui-même, par ses pratiques discriminatoires, a instillé un poison qui corrode aujourd’hui le corps social. Ce racisme d’État n’est plus une hypothèse ; il est une réalité tangible, visible dans la composition des institutions, dans la distribution des postes de commandement, dans l’accès aux richesses nationales et, même, dans les décisions individuelles prises en conseil des ministres.
L’Exécutif, par son silence complice ou son action biaisée, a fertilisé le terrain où prospèrent aujourd’hui ces discours déshonorants. Pour tarir la source de la haine, il ne suffit pas de condamner ses manifestations ; il faut en extirper les racines, par une justice impartiale et une volonté politique inflexible.
- Dans ces discours, on entend ceux qui dénoncent un « racisme d’État », des «discriminations raciales », des injustices de toutes sortes et d’autres qui balaient, d’un revers de main, toutes ces critiques… Qu’en pense le défenseur des droits de l’Homme que vous êtes ?
- En tant que militant des droits humains, je considère que la Mauritanie est confrontée à un problème structurel profond qui a engendré un déséquilibre systémique dans la répartition des richesses et des opportunités. Persistante et croissante, cette injustice revêt malheureusement une dimension ethnique et sociale qui ne peut être ignorée.
Cela dit, si la colère est compréhensible, elle ne saurait justifier des discours qui ciblent indistinctement une communauté ou alimentent la division. Le débat doit avoir lieu mais il doit être mené avec raison, mesure et dans le respect de la dignité de tous. Un dialogue serein est possible, à condition qu’il soit porté par une volonté sincère de comprendre et de réparer.
- L’organisation que vous présidez combat justement les injustices et pour l’égalité entre tous les citoyens. Quelle évaluation fait-elle des efforts des gouvernants pour bâtir une Mauritanie juste et égalitaire ?
- Le principal obstacle à la réalisation des droits humains en Mauritanie réside dans le refus de reconnaître pleinement les injustices historiques et structurelles. Sans un diagnostic honnête et courageux, tous les remèdes ne sont que des palliatifs : ils apaisent temporairement la douleur sans guérir le mal.
L’esclavage et la question du patrimoine humain en sont les tristes illustrations. Des lois existent, des institutions ont été fondées mais leur mise en œuvre reste timide, fragmentaire et, pire, quelques fois déroutante. Plus d’une fois, des cas d’esclavage manifeste ont été pervertis, devant les tribunaux, en de vulgaires conflits de travail.
L’ambassadrice des États-Unis l’a rappelé avec justesse, lors du lancement de l’instance national de lutte contre le trafic des personnes et des migrants : si des progrès institutionnels sont à saluer, le retard dans l’application effective des textes reste criant. Or c’est précisément dans cet écart entre le Droit et le Fait que se niche l’injustice.
- Pensez-vous que le débat sur la question nationale — ou sur la cohabitation, selon les points de vue —, dont les chapelles politiques se sont emparées à travers colloques, séminaires et dîners-débats, sera abordé, débattu et tranché sans passion, une fois pour toutes, lors du dialogue en gestation ?
- Hélas, je suis très sceptique. Certaines questions demeurent presque taboues, puisqu’abordées de travers et non de face. Les détenteurs du pouvoir ne perçoivent pas la coexistence comme un problème nécessitant une remise en cause profonde. Le dialogue, s’il a lieu, risque de n’être qu’un exercice de forme, sans substance ni portée transformative. La volonté politique me semble insuffisante et, sans elle, aucun dialogue ne peut prétendre résoudre les fractures qui traversent notre société.
- Il y a bientôt huit mois que les préparatifs du dialogue sont lancés. Que pensez-vous de la démarche de son coordinateur, monsieur Moussa Fall ? Votre organisation a-t-elle fourni une contribution au dialogue comme l’a demandé le coordinateur ? Si oui, pouvez-vous nous lister les thèmes que votre organisation voudrait voir inscrits aux débats ?
- Je crains que le chemin vers un dialogue véritable ne soit encore long et semé d’embûches. Les obstacles sont nombreux et la défiance reste grande. Notre organisation n’a soumis aucune contribution écrite. Pourquoi ? Parce que beaucoup de zones d’ombres planent sur le processus et aucune garantie de résultats ne nous été donnée. Qui plus est, les tentatives passées ont été étouffées dans l’œuf, sans explication ni transparence. Comment s’investir dans un exercice dont on pressent qu’il n’aboutira à rien de concret ?
- Avez-vous pris connaissance du contenu de la feuille des partis de l’opposition remise au coordinateur ? Si oui, qu’en pensez-vous ?
- Je n’ai pas jugé utile d’examiner ce document en détail. Les thèmes évoqués — esclavage, coexistence, héritage humain, gouvernance — sont connus, ressassés mais jamais véritablement traités. Le problème n’est pas l’absence de sujets, mais l’absence de volonté politique pour les aborder avec sérieux et détermination. Sans cela, les mots ne sont que des coquilles vides.
- Il y a quatre ans que l’École Républicaine a été lancée par le président Ghazouani. Où en est-on, selon vous ?
- L’École républicaine est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car il incarne une promesse : celle d’une éducation unificatrice, capable de transcender les clivages et de forger une citoyenneté commune. Je fus et reste partisan de cette idée que je nomme l’« École républicaine», dans son acception mauritanienne : un creuset où se mêlent toutes les composantes de notre Nation, où nos enfants apprennent ensemble, grandissent ensemble et construisent ensemble l’avenir du pays. Aujourd’hui, force est de constater que notre système éducatif est encore marqué par une forme de ségrégation silencieuse et insidieuse.
Pendant longtemps, la Mauritanie a vécu avec plusieurs écoles: les écoles privées fréquentées par les enfants des élites bidhanes ; celles réservées, de fait, aux enfants négro-mauritaniens ; et l’école publique, souvent reléguée aux enfants des Haratines et des couches défavorisées. Cette séparation n’est pas inscrite dans la loi mais elle existe dans la réalité sociale.
L’idée d’une école unificatrice où tous les enfants apprennent ensemble, sur un pied d’égalité, est révolutionnaire. Elle porte la promesse d’une nation réconciliée avec elle-même. Je salue donc l’engagement du président Ghazouani et l’exemple donné par la ministre de l’Éducation qui a inscrit ses enfants dans une école publique. Cette symbolique est forte mais elle doit s’accompagner d’une généralisation courageuse : que les enfants des ministres, des hauts fonctionnaires, de toutes les élites, d’ouvriers et de paysans partagent les mêmes bancs d’école.
L’enseignement privé a sa place, certes, mais l’État doit veiller à ce que l’école publique soit un lieu d’excellence et de mixité sociale. Je plaide pour un partenariat public-privé équitable où l’État subventionnerait les écoles privées, en échange de l’accueil d’enfants de familles modestes. L’École républicaine n’est pas un projet parmi d’autres : c’est le socle sur lequel se bâtira une Mauritanie unie, fière de sa diversité et forte de son unité. L’avenir de la République commence dans la salle de classe.
- Que pensez-vous du rapport de la Cour des Comptes qui vient d’être publié ?
- Concernant le rapport de la Cour des comptes, je dis que sa publication et sa diffusion exposent les autorités à leurs responsabilités historiques. Des mesures immédiates doivent être prises et tous ceux dont l'implication dans la corruption et le gaspillage des ressources du pays est avérée doivent être punis.
Propos recueillis par Dalay Lam