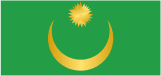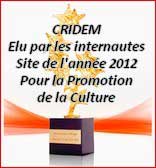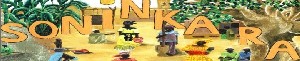17-10-2025 08:29 - Quand le contrôle devient politique, la crédibilité de l’État se joue

Mansour LY -- La publication du rapport 2022-2023 de la Cour des comptes a déclenché un débat rare en Mauritanie. Pour la première fois, un audit public devient matière à discussion nationale. L’État communique, le parti au pouvoir s’en empare, les citoyens commentent. Ce simple mouvement révèle un tournant dans notre culture politique.
Un rapport qui bouscule les habitudes
La Cour a mis en lumière ce que beaucoup savaient sans l’avoir jamais formulé collectivement. Projets inachevés, marchés attribués sans transparence, dépenses mal exécutées, fiscalité défaillante. Ce n’est pas tant la nature des irrégularités qui surprend que la publicité donnée à ces constats.
Pour la première fois, un rapport de contrôle quitte les tiroirs administratifs pour entrer dans la conversation publique. C’est un progrès démocratique, mais aussi un test de maturité collective.
Quand le parti insaf prend la parole avant l’État
Quelques heures après la publication, le Parti Insaf diffuse un communiqué annonçant que le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a ordonné l’application stricte des recommandations. Ce geste, rapide et calculé, cherche à encadrer le récit avant qu’il ne soit capté par d’autres.
Le pouvoir se positionne du côté du contrôle, non de la faute. Le président apparaît comme le garant de la transparence, tandis que l’appareil administratif devient le champ des réformes. Mais cette confusion des rôles interroge. La Cour des comptes s’adresse à l’État, pas à un parti. Quand la communication politique chevauche la reddition institutionnelle, la frontière entre responsabilité et propagande devient poreuse.
La transparence, scène intérieure et vitrine extérieure
Ce discours de vertu parle autant aux Mauritaniens qu’aux bailleurs de fonds. Banque mondiale, FMI, Union européenne, Banque africaine de développement : tous conditionnent leurs appuis budgétaires à des preuves concrètes de bonne gouvernance.
En publiant ce rapport, le gouvernement adresse un message à double lecture. À l’intérieur, il veut rassurer les citoyens sur la volonté d’assainir. À l’extérieur, il veut conforter sa crédibilité auprès de ses partenaires financiers. La transparence devient une diplomatie budgétaire. Elle garantit l’accès aux financements, mais son efficacité dépend des résultats mesurables. Les bailleurs observent désormais les actes, non les annonces.
Le coût de la corruption silencieuse
Derrière les discours, les pertes sont immenses. Le FMI estime que la Mauritanie perd entre deux et trois pour cent de son PIB chaque année en déperditions fiscales et budgétaires, soit environ quinze milliards d’ouguiyas, l’équivalent du budget de la santé et de l’enseignement supérieur réunis.
Cette corruption discrète ne s’affiche pas en scandales, mais en absences. Une école qui n’ouvre pas, des équipements sanitaires incomplets, ou une route mal conçue ou mal construite — comme récemment sur l’axe Timbédra–Vassala, dans le Hodh — où les défaillances techniques ont révélé le coût concret de la négligence. Ce n’est pas l’exception, mais un symptôme.
Ce désastre local porte une leçon générale. Il montre comment les lacunes dans les appels d’offres, le manque de contrôle technique, les sous-traitances opaques et l’absence de suivi post-livraison finissent par faire payer les citoyens. Les entreprises retenues doivent répondre de leurs standards ; les agences de passation de marchés doivent être tenues responsables ; les audits après exécution doivent être publics.
Cette “corruption grise” érode lentement la confiance publique et vide l’État de sa capacité à agir. Un système où l’adjudication prime le contrôle et où le contrôle devient spectacle laisse trop souvent les citoyens seuls devant les dommages concrets. Et surtout, un pays qui ne maîtrise pas ses ressources finit par dépendre des conditions imposées par ses bailleurs.
Le tournant à confirmer
Le président a promis de faire appliquer les recommandations du rapport. L’intention est claire, mais elle n’aura de valeur que si elle s’incarne dans des mesures visibles : un plan d’action publié, un suivi régulier et des sanctions assumées.
Publier un rapport n’est pas un acte de transparence, c’est un commencement. Le contrôle n’a de sens que lorsqu’il transforme la gestion. Sinon, il se réduit à un rituel de communication.
Le pouvoir cherche la stabilité, le contrôle vise la vérité. L’un et l’autre ne s’excluent pas s’ils se rejoignent dans une même exigence de clarté. Un État évalué gagne en légitimité, non en fragilité.La stabilité durable ne naît pas du silence, mais de la confiance que suscite la transparence assumée.
Une leçon politique et citoyenne
La publication du rapport de la Cour des comptes et la réaction qu’elle a provoquée marquent une étape dans la maturation de notre vie publique. Le contrôle n’est plus une menace, il devient une nécessité.
La transparence ne doit pas être une façade diplomatique ni une vitrine budgétaire. Elle doit devenir une méthode d’action, une culture administrative, une exigence partagée.Les partenaires extérieurs y veillent, mais les citoyens y veilleront davantage encore. La vigilance publique devient la meilleure garantie contre les dérives et les compromissions.
La lutte contre la corruption ne se gagne pas dans les discours, mais dans la continuité des corrections.
Mansour LY