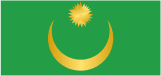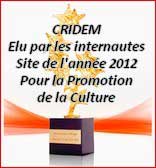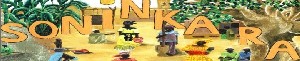15-07-2020 20:16 - La Haute Cour de Justice n’est jamais compétente pour juger un ancien président de la République

Béchir Fall - La Haute Cour de Justice n’est jamais compétente pour juger un ancien président de la République, lequel devenu un citoyen simple n’est justiciable que devant des tribunaux ordinaires de l’ordre judiciaire.
Cette affirmation pourtant bien avérée semble échapper aux juristes de l’Assemblée Nationale. Je suis dès lors stupéfait de voir quatre députés, sûrement animés de bonne foi, déclarer leur intention de réactiver la mise en œuvre prochaine de cette Haute Cour de Justice, d’habitude entourée des plus grands symboles républicains et destinée uniquement à juger le président de la République et les membres du gouvernement en exercice.
L’initiative des députés de mettre en place la Haute Cour de Justice (HCJ) est une décision inopportune car elle remet en cause un ordre juridique cohérent et pourrait engendrer une confusion dans le statut juridique du Chef de l’État.
Elle aboutirait, en effet, à placer sur un même pied d’égalité un chef d’État en exercice et un ancien chef d’État devenu un citoyen ordinaire ne bénéficiant d’aucune immunité pénale, ni de privilège de juridiction. Elle violerait surtout la Constitution.
Pour nous en persuader davantage, relisons attentivement la principale disposition de l’article 93 de notre Constitution, alinéa 1er «Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison.»
Cette phrase rédigée dans un style on ne peut plus simple prévoit ainsi le principe de l’immunité pénale du président de la République en exercice, sauf en cas de haute trahison. En langage juridique, cela signifie que la Constitution accorde au Chef de l’État en fonction durant l’exécution de son mandat deux privilèges fondamentaux : une immunité pénale et un privilège de juridiction. Pour lui permettre d’assurer, selon la formule consacrée, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assurer la continuité de l’État. Le constat saute aux yeux que cette disposition phare de l’article 93 n’est pas destinée à un ancien président. Nous le démontrerons davantage dans ce qui suit.
Cette clause née au 19ème siècle, après avoir parcouru déjà deux siècles sans encombre, est marquée d’une histoire très riche dont nous retracerons brièvement quelques extraits limités dans le cadre d’une interprétation exégétique plus approfondie, absolument nécessaire, pour en saisir le sens et la portée. En effet, si l’on s’en tient à une stricte interprétation littérale de cette disposition symbolique qui aura fait couler beaucoup d’encre à des milliers de pages doctrinales ainsi qu’à des décisions jurisprudentielles de haute facture en France, on risque de n’en jamais saisir la substantifique moelle.
1. L’expression Président en exercice figurant à l’article 93 de la Constitution relatif à la Haute Cour de Justice s’applique uniquement au Président de la République en fonction. Jamais à un ancien président
Une précision sémantique de taille s’impose pour expliciter l’usage par la Constitution de certains termes ou expressions. L’expression en exercice signifie être actuellement en fonction (selon le dictionnaire de l’internaute). Cette expression s’adresse toujours au Président de la République en fonction. En conséquence, l’article 93 relatif à la HCJ concerne exclusivement le Président de la République en exercice dans le cadre d’un mandat présidentiel en cours.
Il est dès lors absolument exclu de croire que tout citoyen ayant occupé cette fonction dans le passé, même récent, puisse être concerné par les dispositions de la Constitution. La réponse est formellement négative. Dans le même ordre d’idées, il convient d’admettre que l’expression Président de la République figurant partout dans la Loi fondamentale ne s’adresse qu’au Chef de l’État en exercice. Jamais à un ancien chef d’État.
D’ailleurs l’expression en exercice était absente depuis la rédaction originelle de cette célèbre clause dans l’article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 relative à l’organisation des Pouvoirs Publics instaurant la 3ème république française. Elle n’a été introduite dans la constitution qu’en 1958 à l’occasion de l’avènement de la cinquième République. C’est dire que les constituants de l’époque ont voulu délibérément anticiper toute velléité d’interprétation. Il serait dès lors quelque peu inhabile de croire qu’un ancien chef d’État puisse être justifiable de la HCJ. On ajoutera - pour appuyer cet argument – que, tout compte fait, l’expression « ancien président » n’existe pas dans notre Constitution.
2. La Haute Cour de Justice ne juge jamais un ancien président de la République devenu un citoyen ordinaire ne jouissant ni d’une immunité pénale ni d’un privilège de juridiction. Les seuls attributs régaliens qui donnent l’accès à la HCJ
Au risque de me répéter – mais la répétition n’est pas une tare en droit, la présente publication n’étant pas un pamphlet littéraire, loin s’en faut – un ex président de la République devenu un citoyen ne peut pas être justiciable de la Haute Cour de Justice. Je suis assez étonné que beaucoup de bons juristes n’arrivent pas à distinguer le statut de Président de la République en exercice et celui d’ancien président qui ne jouit, ni d’une immunité pénale, encore moins d’un privilège de juridiction, attributs régaliens exclusivement attachés à une fonction présidentielle en activité.
Il n’est pas souhaitable, ni même efficace que des personnes susceptibles d’être inculpées dans une procédure de justice puissent être traduites devant une instance mi politique, mi juridictionnelle où la confusion entre le politique et le pénal, au détriment de la vérité juridique, risque de peser sur les décisions finales. Et manquer l’objectif recherché, celui d’aboutir à mettre fin à l’impunité qui fait rage dans notre pays depuis plusieurs décennies.
En conséquence, l’idéal serait de confier tous les dossiers relatifs aux crimes et délits financiers à une nouvelle cour de l’ordre judiciaire à vocation financière et économique dont les missions pourraient être densément fixées en fonction des enjeux encourus. Si, pour lutter contre l’esclavage, l’État a mis en place plusieurs cours de justice, il peut parfaitement procéder pareillement pour réprimer plus efficacement les criminels et délinquants financiers ou économiques.
Alors pourquoi tenterions-nous inutilement de mettre en œuvre la Haute Cour de Justice pour juger un citoyen qui, dans un passé récent, a exercé la fonction de président de la république ? La Haute Cour de Justice ne jugeant qu’un Président de la République actuellement en fonction, cette tentative de la réhabiliter semble vouée logiquement à l’échec. Nous oserions croire que la présente publication contribuera à lever les incertitudes qui pèsent sur le sujet.
Et nous réaffirmons avec force qu’en tant que citoyen, un ex président demeure exclusivement justiciable des juridictions de l’ordre judiciaire de la République où siègent en permanence des magistrats professionnels plus compétents et, en principe, plus neutres que des parlementaires réunis dans une improbable HCJ.
3. Les présidents Chirac et Sarkozy ont été condamnés par des tribunaux ordinaires à la fin de leurs mandats présidentiels respectifs
Pour illustrer la règle selon laquelle les anciens présidents ne sont jamais justiciables de la Haute Cour de Justice qui ne juge que les présidents en exercice, intéressons-nous à l’exemple des chefs d’État français qui ont eu maille à partir avec la justice de leur pays.
Le premier, Jacques Chirac, a été condamné par un tribunal correctionnel (un tribunal de droit commun) de Paris, en 2011 après la fin de ses mandats présidentiels, à deux ans de prison avec sursis dans l’affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Pour l’ex président Sarkozy, la Cour de cassation confirme en octobre 2019 son renvoi devant un tribunal correctionnel, le même qui avait jugé son prédécesseur, pour des dépenses excessives de sa campagne présidentielle en 2012.
Imaginons que ces deux anciens chefs d’État ont été attraits sans difficulté devant des tribunaux de droit commun de leur pays, comme tout citoyen ordinaire, pour des affaires mettant en jeu des montants litigieux sans doute 100 fois moins importants que ceux évoqués au cours de l’enquête conduite par la commission parlementaire de notre Assemblée Nationale concernant des hommes politiques interrogés ou cités devant elle.
4. L’histoire des cours spéciales avec une majorité de parlementaires chargées de juger des responsables de l’exécutif en France est jalonnée d’échecs retentissants les discréditant pour toujours
Une suspicion légitime de parti pris politique et d’inefficacité manifeste entoure ces fameuses Cours de Justice composées à 80 % de députés et seulement 20% de magistrats. Elles créent un déséquilibre structurel au profit des parlementaires qui sont des hommes politiques pouvant être tentés de faire preuve d’indulgence à l’égard d’autres hommes politiques comme cela a été observé en France.
D’où une surabondance des peines de sursis en France concernant des hommes politiques à tel point que depuis sa création, le 27 juillet 1993, la Cour de Justice de la République (CJR), chargée de juger les membres du gouvernement, est fortement contestée. De sorte que sa suppression est maintes fois envisagée. En raison d’une réputation ternie par plusieurs scandales. Elle condamne rarement à une peine d’emprisonnement. Et si c’est le cas, la condamnation est assortie d’une dispense d’exécuter la peine d’emprisonnement. Un subterfuge imaginé par la CJR pour éviter les affres de l’emprisonnement aux hommes politiques.
Sait-on surtout qu’en 74 ans d’existence de la Haute Cour de Justice, depuis l’avènement de la constitution de la quatrième république en France en 1946, celle-ci ne s’est jamais réunie, ni jugé un chef d’État du crime de Haute Trahison. Une hibernation digne d’un fossile de l’ère quaternaire ! Et nos honorables députés sont vent debout pour envisager l’exhumation de cette HCJ. Moralité : les cours de justice majoritairement formées de parlementaires ne sont pas créditées ailleurs d’une grande efficacité.
5. Les conclusions de l’enquête parlementaire doivent être impérativement transmises au ministre de la Justice lequel fera diligenter l’action publique par le parquet général
L’enquête parlementaire, dont il faut souligner la pertinence, une attrayante leçon de transparence démocratique et l’accomplissement d’un travail remarquable, doit suivre son cours normal jusqu’à la rédaction finale de ses conclusions. Après leur validation par l’assemblée nationale, elles doivent être transmises sans tarder au ministre de la Justice aux fins du déclenchement de l’action publique ; dès la réception des conclusions, le ministre devra impérativement ordonner au parquet général d’ouvrir une information judiciaire dans les plus brefs délais.
Les conclusions de l’enquête pourraient servir très utilement dans le cadre, d’une part de l’étape de la poursuite, puis de l’instruction qui devra être assurée préférentiellement par une chambre d’accusation collégialement formée en raison de la densité du dossier, de la qualité des témoins ou des personnes susceptibles d’être inculpées et, même au-delà, dans la phase de jugement.
Il est souhaitable que le ministre de la justice puisse, dès à présent, ouvrir plusieurs chantiers pour faire face aux enjeux qu’induirait la forte demande de ce grand dossier étant entendu que les précédents régimes n’ont jamais fait du besoin de moralisation de la vie politique une priorité absolue.
Béchir Fall, Juriste et Expert en Stratégies Sociales