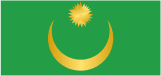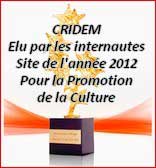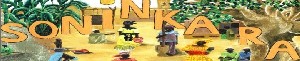01-05-2025 21:00 - Gaza et la conscience noire : quand la mémoire défie l’Empire / Par Mohamed El Mokhtar Sidi Haiba

Entre Gaza et l’Amérique noire, une fraternité inattendue se dessine — non de circonstance, mais de conscience. Forgée dans l’expérience commune de la dépossession, de l’effacement et de la violence d’État, cette solidarité dérange car elle est lucide.
Dans la cacophonie des justifications sionistes et des complicités impériales, une nouvelle voix s’élève — de Detroit à Brooklyn, des studios de CNN aux travées du Capitole. C’est celle de l’Amérique noire — indocile, insoumise, et de moins en moins disposée à taire le nom de la Palestine.
De Briahna Joy Gray à Marc Lamont Hill, de Ta-Nehisi Coates à Joy Reid, de Jamal Bowman et Cori Bush jusqu’à la bravoure prophétique de ceux qui les ont précédés, un fil se dessine — non celui de l’opportunisme, mais de la lucidité.
Ces voix, forgées dans le creuset de l’injustice raciale américaine, voient en Gaza non un simple carnage, mais un miroir. Une continuité logique de la déshumanisation, de la violence d’État et de l’effacement narratif qu’elles connaissent intimement.
Ce qui irrite les lobbies pro-israéliens, ce n’est pas seulement la solidarité de ces figures afro-américaines avec la Palestine — c’est leur compréhension. C’est qu’elles osent tisser un lien entre Ferguson et Jénine, entre les quartiers rouges et les checkpoints, entre l’incarcération de masse et le blocus de Gaza. Elles étaient censées rester confinées aux plaies “domestiques” de l’architecture raciste des États-Unis. Mais elles ont lu Said, Kanafani, Darwish — et percé le voile de l’Empire.
Car la Palestine, pour les opprimés, n’est pas une cause étrangère. C’est la frontière la plus visible de l’Empire. Se tenir aux côtés de Gaza, ce n’est pas trahir la lutte noire — c’est l’universaliser. C’est affirmer que le genou qui broie la nuque à Minneapolis et la bombe qui ensevelit des enfants à Rafah appartiennent au même arbre.
Il arrive que des peuples séparés par les océans, les langues et les blessures se reconnaissent sans s’être jamais croisés. Le cri de Gaza résonne dans une église de Harlem, dans les rues de Ferguson, dans la prose incandescente de Coates, ou dans le regard inébranlable d’Angela Davis.
Ce cri, aujourd’hui, est porté par l’Amérique noire — un peuple vieilli par la mémoire et affermi par la résistance.
Bien avant les hashtags et les éditoriaux, Stokely Carmichael nommait déjà l’Empire, le désignait comme ennemi — liant le colonialisme lointain au racisme intime. Angela Davis porta cette clarté jusque dans les prisons et les amphithéâtres. Alice Walker l’inscrivit dans la littérature. Cynthia McKinney fut une éclaireuse au Congrès, défiant AIPAC avant que cela ne soit dicible. Et dans le monde académique, Cornel West demeura debout — inébranlable, poétique, et farouche.
Les voix d’aujourd’hui se tiennent sur leurs épaules. Mais elles en paient le prix.
Marc Lamont Hill fut écarté. Briahna Joy Gray, congédiée. Joy Reid, licenciée. Le professeur Steven Thrasher suspendu pour avoir manifesté sa solidarité avec Gaza à Northwestern. Cori Bush et Jamal Bowman, politiquement ciblés et expulsés — non pour leurs fautes, mais pour leur fidélité. Cynthia McKinney elle-même ne fut pas vaincue — elle fut effacée.
Car en Amérique, se souvenir trop profondément, aimer la justice trop passionnément — cela se paie.
Ce qui trouble les gardiens de l’orthodoxie sioniste, ce n’est pas l’émotion de ces voix — c’est leur savoir. Ils ont lu Ilan Pappé, écouté Rashid Khalidi, débattu avec Noura Erakat, suivi Diana Buttu et Michael Tarazi dans le labyrinthe du droit dévasté, entendu Hanan Ashrawi porter la résistance avec dignité, et pleuré avec les enfants de Gaza. Ils portent la clarté de Rabbani Mouïn, l’audace morale de Ramzy Baroud, la vigueur implacable d’Ali Abunimah. Ils ont entendu Ayman Mohyeldin percer le brouillard de la propagande médiatique.
Ils n’ont pas emprunté la cause palestinienne — ils l’ont reconnue. Parce qu’ils connaissent les barrages. Parce qu’ils savent ce que c’est d’être désigné comme “menace”. Parce qu’ils ont vu l’expulsion grimée en politique publique, et le meurtre camouflé en sécurité. Ils savent que Gaza n’est pas un champ de bataille — c’est un laboratoire d’effacement.
Et c’est cela qui effraie : une conscience noire qui refuse de rester domestique. Qui refuse la laisse.
On les attendait à Selma — pas à Shujaiya. Mais ils savent, comme Fanon l’avait vu, que l’Empire migre : des chaînes aux drones, des fouets aux algorithmes.
Pendant ce temps, d’autres — éloquents mais vidés de solidarité — choisissent la conciliation au lieu de la vérité. Don Lemon préfère le choix de la complicité au fracas des morts en direct. John McWhorter, aux côtés de Glenn Loury, requalifie l’occupation et le génocide en complexité regrettable. Il ne pleure pas Gaza. Il en justifie la destruction. Il ne nie pas le sang. Il le désamorce. Ainsi rejoint-il la longue lignée des intellectuels qui assainissent le crime, non en niant les faits, mais en les vidant de leur sens.
Mais Gaza avait déjà parlé :
« Déchirez nos noms. Brûlez les cartes. Effacez nos livres.
Festoyez. Dansez. Oubliez-nous.
Mais sachez ceci : dans vos miroirs, nos visages reviendront.
Et quand nous serons partis… ce sera votre tour. »
Ce n’est pas une menace. C’est une loi de l’Histoire.
La justice que vous trahissez se lèvera un jour, et vous demandera : Où étiez-vous ?
Black Lives Matter a compris. Black for Palestine aussi. Car Gaza n’est pas un désaccord diplomatique — c’est une frontière morale. C’est là que ceux qui se souviennent se reconnaissent, au-delà des frontières, des langues, et des ruines. C’est là que la lutte devient indivisible. Et que le silence devient complicité.
Alors non — la question n’est pas : Pourquoi l’Amérique noire soutient-elle Gaza ?
La véritable question est : Comment a-t-on pu croire qu’elle oublierait d’où elle vient ?
Et si l’on tend l’oreille, sous les chants et les gravats, un autre rythme émerge.
Dans les sons brisés de l’oud, on entend la tendresse rageuse de Nina Simone. Dans le tremblement indomptable de Julia Boutros, la gravité solennelle d’un chant de résistance. Ces deux traditions musicales — nées sous le siège et la douleur — ne se contentent pas de survivre : elles sanctifient. Elles rappellent au monde que les peuples qui chantent leur douleur finiront, tôt ou tard, par chanter leur délivrance.
---
Mohamed El Mokhtar Sidi Haiba est analyste politique et social, passionné par les dynamiques géopolitiques et les imaginaires postcoloniaux en Afrique et au Moyen-Orient. Ses articles ont été publiés dans Middle East Eye, The Palestine Chronicle, Third World Resurgence, Al Ahram Weekly, et Morocco News.
Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité.