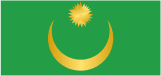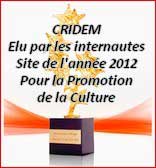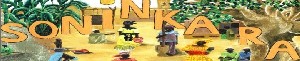23-11-2025 00:01 - Le 28 Novembre ne pourra unir la Nation que si nous assumons toute notre histoire / Par Mansour LY

En Mauritanie, le 28 novembre porte deux récits qui s’ignorent encore, celui de l’indépendance retrouvée et celui d’un drame infligé à des soldats mauritaniens en 1990. Comment célébrer une date qui rassemble et qui blesse à la fois? La question n’est plus un tabou, elle est devenue un enjeu national majeur.
Chaque année, le 28 novembre réapparaît avec sa dualité. Il rappelle le moment fondateur de notre souveraineté, conquise à l’issue d’un long processus politique, mais il évoque aussi la tragédie d’Inal où vingt-huit soldats mauritaniens furent exécutés par des membres de la chaîne de commandement d’alors.
Ces deux dimensions, l’une glorieuse, l’autre profondément douloureuse, se trouvent réunies dans un même jour alors que les Mauritaniens n’en portent pas la même résonance.
Cette coexistence révèle une vérité essentielle. Aucune nation ne peut se construire durablement lorsque deux blessures marchent sur des voies séparées, lorsque deux mémoires ne se reconnaissent pas, lorsque deux récits fondamentaux avancent sans jamais se rencontrer. La construction nationale repose sur la capacité d’un peuple à regarder ses cicatrices ensemble, à nommer ses vérités, à comprendre que la maturité collective commence là où cesse la peur d’assumer son histoire.
La Mauritanie se trouve aujourd’hui précisément à ce seuil. Le chemin de la Nation est rarement une route tranquille. Il est souvent traversé de contradictions, de non-dits, de douleurs enfouies. Les peuples qui avancent sont ceux qui choisissent un jour de regarder leurs ombres en face. Et c’est dans cette démarche que se mesure la grandeur d’un pays.
Les Mauritaniens ne s’opposent pas sur les faits, ils manquent d’un langage commun
Les débats récents l’ont montré. Les Mauritaniens ne divergent pas sur ce qui s’est passé, mais sur la signification qu’il faut donner au 28 novembre. Pour beaucoup, cette date reste un pilier de la souveraineté nationale. Pour d’autres, elle demeure une plaie vive. Certains dénoncent les usages politiques qui en sont faits. D’autres appellent à une reconnaissance claire du drame d’Inal.
Ces sensibilités, loin d’être contradictoires, expriment toutes un même besoin. La Mauritanie manque d’un récit où mémoire et souveraineté puissent coexister sans se nier. Ce n’est pas la date qui nous divise. C’est l’absence d’un cadre symbolique dans lequel chacun puisse se reconnaître sans que son histoire soit effacée ou minimisée.
Le faux dilemme entre la Nation et la reconnaissance
Il serait injuste d’exiger des familles des victimes qu’elles célèbrent malgré la douleur. Il serait tout aussi problématique de demander au reste du pays de renoncer à commémorer l’indépendance. La Mauritanie n’a pas à choisir entre sa dignité nationale et la reconnaissance de ses morts. La réconciliation véritable consiste à donner à la mémoire et à la souveraineté des espaces distincts, afin que chacun puisse exister sans heurter l’autre.
Lorsque l’on tente de fusionner des émotions qui ne relèvent pas de la même logique, les tensions apparaissent. Lorsque l’on clarifie les rituels, elles s’apaisent. Reconnaître les victimes n’enlève rien à la fierté nationale. Célébrer l’indépendance n’efface pas les douleurs. L’un ne doit pas étouffer l’autre.
La voie d’honneur qui permet d’unir plutôt que de diviser
Il existe une solution digne et apaisante. Elle consiste à structurer nos rituels sans diviser notre peuple. La création d’une Journée nationale de la Mémoire et de la Dignité, organisée le 27 novembre ou à une date consensuelle, offrirait un espace officiel dédié à Inal, à Oualata et à toutes les victimes des violences politiques.
Ce moment solennel affirmerait que la Mauritanie n’a pas peur de regarder ses blessures. Le 28 novembre pourrait alors retrouver sa vocation première, celle de célébrer la souveraineté et l’unité nationale. Clarifier les fonctions symboliques ne sépare pas les Mauritaniens. Au contraire, cela leur permet de marcher ensemble.
Ce que nous apprennent les histoires de l’Algérie et de la France
Les nations qui deviennent fortes sont celles qui affrontent leurs mémoires blessées avec courage. L’Algérie en est un exemple saisissant. Elle a connu la guerre d’indépendance, l’une des plus brutales du siècle dernier, puis la “décennie noire”, marquée par les massacres, les disparitions, la peur quotidienne. Ce pays aurait pu se fracturer définitivement. Il a pourtant choisi un chemin difficile, celui de la réconciliation nationale, qui a permis de reconstruire un minimum de cohésion et d’empêcher la société de sombrer dans un cycle sans fin de vengeance.
La France, de son côté, porte une histoire marquée par la Terreur révolutionnaire, les guerres civiles, la Commune de Paris, les rafles, les déportations, les violences coloniales, les blessures sociales, les drames de Vichy. C’est à travers des commissions, des lois mémorielles, des excuses officielles, des musées, une mise en lumière progressive des pages sombres que la France a pu éviter que ses fractures historiques ne deviennent irréparables.
Dans ces deux pays, l’État a joué un rôle central. Il a assumé son devoir moral, guidé le débat public, ouvert des espaces de dialogue, accepté de nommer les douleurs. Sans un État debout et clair, aucune réconciliation n’aurait été possible.
Et cet enseignement concerne directement la Mauritanie. Une Nation ne se réconcilie jamais en silence. Il faut un État capable d’assumer une autorité morale, un rôle de gardien de la mémoire et une volonté de rassembler. S’il reste hésitant, si sa parole est incertaine, les blessures continueront de traverser la société. En revanche, un État qui s’engage fermement sur la voie de la vérité et de la dignité peut devenir l’architecte d’une réconciliation authentique.
Cette démarche doit inclure toutes les communautés, celles qui portent la douleur, celles qui ont été témoins, mais aussi celles qui n’ont pas été touchées directement et qui souhaitent contribuer à l’unité nationale. La réconciliation véritable n’a pas pour but de créer de nouvelles catégories de victimes, mais de mettre fin à toutes les douleurs pour faire naître une Mauritanie réconciliée où chacun se sent pleinement membre de l’histoire commune.
Le pacte que nous devons transmettre à nos enfants
Nous sommes à un moment de vérité. Le 28 novembre peut rester une date crispée ou devenir un symbole partagé. La Mauritanie décidera de son avenir selon la manière dont elle assumera son passé. Une Nation ne peut se développer avec deux vérités isolées ou deux mémoires qui s’ignorent. Nous devons accepter de regarder notre histoire ensemble, de nommer nos douleurs, de reconnaître nos blessures, d’offrir justice et dignité à ceux qui ont souffert.
Et il faut rappeler une vérité que nous oublions parfois. Après l’indépendance, la Mauritanie a accompli une prouesse rare. Malgré nos différences de tribus, d’ethnies, de cultures et de territoires, nous avons réussi à vivre ensemble, à construire une cohésion fragile mais réelle, à inventer une manière mauritanienne d’exister collectivement. Ce travail fut difficile, silencieux, parfois invisible, mais il a été réel. Et il constitue l’un de nos plus grands acquis.
Aujourd’hui, une nouvelle génération se lève. Elle porte moins les blessures d’hier que l’espoir d’une Mauritanie plurielle, inclusive et confiante. Nous lui devons un récit national renouvelé, où chacun a sa place, sans hiérarchie implicite, dans une mémoire assumée.
Si nous réussissons cela, alors le 28 novembre deviendra enfin ce qu’il doit être, une date d’orgueil, de dignité retrouvée et de fierté partagée. Un moment où chaque Mauritanien, d’où qu’il vienne, se reconnaîtra dans un même horizon et un même destin. Une fête nationale authentique, capable d’unir la Nation tout entière.Nous devons à nos morts la vérité. Nous devons à nos vivants la justice. Nous devons à nos enfants une Mauritanie arc en ciel, souveraine et pleinement elle-même.
Mansour LY
Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité.