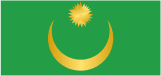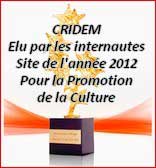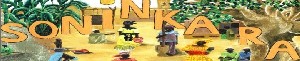01-09-2025 19:21 - Témoignages (Extraits) Par maître Taleb Khyar o/ Mohamed Mouloud*

Monsieur Gérard Beaumont était imposant par sa haute stature, portant constamment une saharienne confectionnée sur ses mensurations, à coupure droite, aux manches courtes, et un pantalon bouffant connu à l’époque sous le nom de « laisse-tomber », à la taille ajustable par un cordon intérieur en cuir lisse ou « kshatt », dont la partie proéminente descend le long des jambes ;
ses chaussures, à l’anatomie similaire à celles des chameliers, étaient en cuir tanné, la semelle surmontée de lanières croisées autour des chevilles, avant de s’en aller enrouler le tendon d’Achille ; une paire de ces lanières se détachait, dévalant le dos du pied, pour venir se fixer dans l’interstice séparant le gros orteil du second ;
il avait toujours au coin des lèvres, une pipe à gros foyer tel un accessoire indissociable de sa silhouette ; il s’en dégageait à chaque bouffée, une odeur aromatique qui embaumait l’atmosphère ; les connaisseurs disaient de ce tabac qu’il provenait d’Amsterdam.
Malgré sa stature imposante, sa présence respirait la convivialité plus que l’intimidation.
Ayant réussi le certificat d’études primaires haut la main, monsieur Gérard Beaumont m’autorisa à m’inscrire comme auditeur libre, en première année du secondaire, au prestigieux lycée de Rosso, connu alors sous l’appellation de « lycée Xavier Coppolani ».
Annoncé par un portail démesuré aussi bien par sa largeur que par sa hauteur, le lycée était situé à une dizaine de kilomètres de la ville, au bout d’une piste aménagée pour être carrossable.
De prime abord, le lycée m’est apparu relever d’une architecture peu courante à l’époque ; conçu comme un village, serpenté par des ruelles sinueuses pavées, délimitées d'un côté comme de l'autre de haies d’arbrisseaux à mi-hauteur d'homme, touffus mais soigneusement taillées, dont l’alignement était par endroit ponctué d’espaces dégarnis, permettant d'accéder aux classes adjacentes, ainsi qu’aux terrains de basketball et de volleyball ; par contre, celui de football était volontairement aménagé à la lisière du lycée, pour éviter que les élèves ne soient divertis par les compétitions, de nature à mobiliser des foules importantes dont la présence pouvait perturber le bon déroulement des cours.
Les bâtiments où se dispensaient les enseignements étaient éparpillés de manière disparate, non sans une touche d’harmonie, à proximité de ce qui devait être le siège administratif ; un peu plus loin au sud, se trouvait un gigantesque réfectoire, dont la capacité d’accueil surpassait sans doute le nombre d’élèves, alors assez limité, et qui s’y restauraient avec appétit au petit déjeuner, déjeuner et dîner.
A proximité du réfectoire, se dressait l’infirmerie, suffisamment équipée en moyens techniques et personnel qualifié, pour offrir dans l’urgence les premiers soins à tout élève exposé à des soucis de santé.
Au sud-est du siège administratif, s’étalait le dortoir où les élèves admis en internat, faisaient obligatoirement la sieste, en attendant de reprendre les cours d’après-midi ; une fois ces cours achevés, ils avaient la faculté de se détendre, en attendant le repas du soir, puis ils devaient nécessairement rejoindre le dortoir, après un bref passage dans les classes de permanence pour des séances de révision sous l’œil vigilant de quelque surveillant.
Les heures de sommeil, qu’il s’agisse de celles de la sieste ou de la nuit, étaient respectées avec rigueur ; un véritable rituel ; à ces moments-là , on avait le sentiment qu’il n’y avait plus âme qui vive au lycée ; le même silence de plomb régnait également à l’intérieur du dortoir, sous l’autorité du surveillant général, l’imposant et autoritaire monsieur Louly, dont la présence dissuadait à elle seule tout pensionnaire de déroger au sacerdoce du silence.
Plus au nord du siège administratif, se trouvaient les habitations des enseignants , à l’abri de certains arbres fruitiers et d’ombrage; parmi ces arbres, ceux qui m’avaient le plus marqué étaient les manguiers, disséminés un peu partout sans être envahissants, et qui propageaient une ombre à l’abri du soleil, dont les effets incandescents s’en trouvaient ainsi atténués ; il y avait ici et là quelques citronniers, et autres plantes caractéristiques de la savane.
Le lycée abritait en quelque endroit reculé, un garage où se parquait et se réparait en cas de besoin l’unique camion destiné à servir de moyen de transport à la poignée d’externes dont je faisais partie, et qui se regroupaient au niveau de la poste communale, alors unique lieu de ramassage ; c’est à cet endroit que le chauffeur venait nous récupérer, et c’est là également qu’il nous déposait à la fin des cours ; il était d’une ponctualité de métronome, et gare aux retardataires qui n’avaient d’autre choix que celui de se procurer à titre personnel un autre moyen de transport ou de se résigner à s’absenter , ce qui n’était pas du goût des enseignants de l’époque, l’auteur étant sanctionné lourdement ; lorsque cette absence coïncidait avec la période des examens , elle pouvait valoir à l’intéressé un zéro pointé dans la matière ratée, à moins qu’il ne présentât une raison qui puisse le relever de la mauvaise note encourue ; cette rigueur disciplinaire explique à bien des égards, la ponctualité suivie et généralisée des externes, aux heures de ramassage.
Les professeurs étaient en majorité des coopérants français, à l’exception de monsieur Sakho, professeur de mathématiques qui dispensait ses cours en sixième, cinquième et quatrième, avec un savoir-faire qui vous donnait envie d’en approfondir le contenu ; après ses explications, les équations du second degré, les factorisations et autres théorèmes nous étaient plus accessibles ; et puis monsieur Sakho ne semblait fournir un quelconque effort pour communiquer cette science qualifiée de nos jours de science dure, et qui, au vu de ses explications devenait accessible à tous les élèves de la classe, y compris les moins doués ; il s’habillait à l’occidentale, arborant invariablement des tenues estivales qui renforçaient son allure détendue ; il y avait également comme professeur de nationalité mauritanienne, monsieur Diop, enseignant du français; il avait un penchant particulier pour les auteurs de tragédies, et ne manquait pas de nous faire réciter la tirade de Don Diègue empruntée au « Cid » de Corneille ; c’est à cette époque que je me passionnai pour la lecture et que je fis de « Madame Bovary » de Gustave Flaubert, mon livre de chevet que je ne me suis jamais lassé de lire, y compris à ce jour ; enfin, il y avait monsieur Tatoum (sans doute un sobriquet affectueux) professeur de sport, virtuose en basketball et qui impressionnait par sa taille démesurée, d’une sociabilité à toute épreuve, et dont le lancer-franc ne ratait jamais le panier.
Parmi les professeurs français, Je retiendrai monsieur Auguste, enseignant en géologie, qui dictait son cours plus qu’il ne l’expliquait; cette discipline m’est toujours apparue comme devant être enseignée dans quelque centre professionnel plus que dans un lycée, du fait de son caractère pratique et interdisciplinaire, relevant à la fois de la géographie, de l’étude des roches, de l’archéologie, et autres sciences de la terre ; j’avais le même sentiment à l’égard des cours de sciences naturelles pendant lesquels on nous apprenait à disséquer le corps humain à la vue d’un squelette artificiel que l’on semblait vouloir s’entêter à réincarner.
J’avais un penchant affirmé pour le cours d’anglais, dispensé par mademoiselle Chipin, ceux de français et de mathématiques dispensés respectivement en classe de troisième, par madame Beaudoin et monsieur Milcent.
Contrairement aux autres professeurs, madame Beaudoin résidait en ville avec son époux de nationalité également française dont on disait qu’il était ingénieur, et qu’il avait en charge de surveiller le niveau du fleuve, en veillant au bon fonctionnement du système d’écluses qui en régulait le débit ; leur maison était adossée à la partie de la digue qui cernait la ville au sud, à proximité du barrage, au bord de la seule rue bitumée de Rosso parsemée de représentations des comptoirs français dont Buhan & Tesseire, Maurel & Prom et la maison Lacombe.
Cette rue prenait naissance à partir du quai où s’accostait le bateau Bou El Mokdad, un peu plus loin à l’ouest, mais sur le même alignement que le bac reliant les deux rives du fleuve Sénégal, par lequel transitaient marchandises, voitures et personnes dans les deux sens.
Grâce au Bou El Mokdad, Rosso était un haut lieu de flux et d’échanges commerciaux ; le bateau y débarquait toutes sortes de produits et denrées en provenance de Saint-Louis, Richard Toll, Podor, Kaédi, Matam, Bakel, avant de reprendre le même itinéraire, rempli d’autres produits et denrées, pour ravitailler en sens inverse les villes-étapes ; le bateau servait également à transporter des personnes.
Son activité devenait intense pendant l’hivernage, puisque les régions orientales étaient isolées du reste de la Mauritanie par manque de routes terrestres praticables du fait des inondations, et les négociants de ces régions ne pouvaient commercer qu’au niveau des différentes escales du Bou El Mokdad.
Ces négociants rejoignaient Rosso avant les premières averses de la saison des pluies, constituaient des stocks de marchandises qu’ils faisaient ensuite transporter par le Bouel Mokdad vers les villes côtières de destination, ou celles qui en étaient les plus proches.
Un siècle plus tôt, Faidherbe avait asséché la transsaharienne dont le trafic intense était perçue par le colon comme alimentant la résistance qui se nourrissait des échanges entre le sud du Maroc et Tombouctou.
Ces échanges entretenaient la rébellion, incontrôlable du fait de l’immensité du Sahara ; c’est alors qu’il fut décidé de transférer à Saint Louis les produits traditionnellement stockés à Tombouctou, asséchant de la sorte le trafic transsaharien ; Saint-Louis va devenir alors un carrefour stratégique où s’échangent les produits en provenance du soudan, contre ceux acheminés par la côte Ouest longeant l’atlantique, le tout au détriment de Tombouctou dont le déclin va se poursuivre.
Grâce au Bou El Mogdad, le trafic devenu intense pourra être acheminé de Saint-Louis à toutes les villes longeant le fleuve Sénégal, de Rosso à Bakel.
Madame Beaudoin était jeune par rapport à la moyenne d’âge de ses collègues, et pourtant c’est grâce à ces cours d’une grande accessibilité que les modes expressifs n’eurent plus de secrets pour nous, à un point tel que nous finîmes par comprendre que dans chaque mot, il y a la vie et la mort, le dit et le non-dit, l’harmonie et le désordre, la musique et le bruit, l’espoir et le désespoir ; que chaque mot porte en lui une diversité que son auteur est capable, en fonction de ses sensibilités, d’illuminer de toutes les couleurs de la vie, ou d’assombrir de toutes les pâleurs de la mort ; qu’à côté de la prose, existe un autre mode alternatif d’expression, plus musical, plus harmonieux, que l’on attribue aux poètes, une espèce humaine qui dit les choses différemment, mais avec une intensité immuable ; la versification n’avait plus de secret pour nous ; nous savions que les rimes pouvaient être plates ou croisées ….Qu’il fallait calculer le nombre de pieds composant un vers pour distinguer l’alexandrin du quatrain, de l’octosyllabe, du décasyllabe……..Que chaque syllabe comptait pour un pied, et que la lettre muette n’avait pas d’incidence sur la longueur d’un vers..
De l’analyse grammaticale à l’analyse logique, en passant par la compréhension des textes, nous avons fini par percevoir que la conjugaison est la première forme de socialisation ; le « tu » par opposition au « je », le « vous » par opposition au « nous » », l’autre par opposition à « soi » sont là pour nous rappeler que nul n’est le nombril du monde, et que nul ne saurait l’être ; une belle leçon de vivre ensemble que nous a apprise madame Beaudoin.
Ce serait vain de vouloir s’étendre sur les qualités pédagogiques, intellectuelles de madame Beaudoin ; on retiendra qu’elle a confisqué le printemps de sa jeunesse, celui de son valeureux époux, en quittant sa douce France au moment des trente glorieuses, l’une des périodes les plus fastes de l’économie contemporaine de la France, pour s’en aller enseigner aux enfants d’une contrée lointaine et reculée, les secrets de la langue française ; sa richesse, ses couleurs, ses nuances, son humanisme.
Sous la houlette de monsieur Gérard Beaumont, le lycée Xavier Coppolani de Rosso n’était pas seulement un centre d’excellence, c’était aussi un espace où les différences se conjuguent, comme l’illustraient nos équipes colorées de football, basket, volleyball et handball, comme l’illustraient les dortoirs où les lits étaient attribués sans distinction de races, d’origine sociale ou régionale, comme l’illustrait le réfectoire où les élèves s’asseyaient côte à côte, toutes races confondues, pour dévorer avec appétit les plats du « cuistot » Chedad, sobriquet affectueux que l’on attribuait au cuisinier principal, comme l’illustrait le camion que conduisait avec talent et tact le virtuose « Vieux Sidibé » qui venait chercher sans discrimination les externes habitant à sept kilomètres de lycée, du côté de la poste municipale, seul point de ramassage, et nulle part ailleurs.
Le lycée était un haut lieu de brassage culturel et social, même s’il était perceptible, au vu de la composition des différentes équipes lors des compétitions que les basketteurs appartenaient majoritairement à la vallée, tandis que les footballeurs étaient en majorité originaires de l’Adrar.
Il n’était pas rare de voir certains sportifs associer l’excellence sur les terrains de sport à celle sur les bancs du lycée ; je pense notamment à Haibatna, dont la conduite de balle et les dribles couronnés souvent par un but dans le camp adverse suscitaient à chaque fois un tonnerre d’applaudissements ; il raflait d’un autre côté tous les prix d’excellence décernés dans toutes les matières, aussi bien littéraires que scientifiques, laissant aux autres élèves les seuls prix d’honneur ou d’encouragement.
A cet égard, il faut rappeler qu’il n’est jamais arrivé qu’un élève contestât ses notes de fin d’année, chacun de nous étant convaincu que l’égalité des chances était au centre de toutes les évaluations de niveau, fussent-elles relatives aux devoirs, compositions de mi-parcours, ou autres examens de fin d’année.
C’était tout cela, le lycée de Rosso, mais tout cela allait disparaître avec le départ de monsieur Beaumont ; c’est la raison pour laquelle, il faut regretter que son poste ait été nationalisé de manière prématurée, pour le seul motif que la langue française avait été mêlée à un sujet de marchandage politique, au rabais bien sûr, comme tous les marchandages du même genre, pendant lesquelles des élites en mal d’inspiration et à la vision obscurcie par des intérêts personnels, sacrifient l’avenir de plusieurs milliers d’enfants et d’adultes, pour satisfaire des ambitions sans lendemain.
Le départ de monsieur Gérard Beaumont était annonciateur d’une nouvelle ère, où les particularismes de tous bords, arabisme et africanisme, ethnocentrisme plus tard, allaient s’entredéchirer, chacun voulant imposer sa culture à l’autre ; cela va alimenter les schismes qui ont détruit et continuent de détruire la cohésion sociale.
Après Gérard Beaumont, les conflits interculturels vont très vit remonter en surface ; on les croyait oubliés, enterrés à jamais ; que la Mauritanie avait résolument opté pour une société égalitaire, et que cette égalité se ferait par l’école, dont la mission première était perçue comme visant le remplacement de la culture communautaire par celle de la citoyenneté, le gommage des particularismes par l’égalité, la création d’une élite qui prendrait à cœur les problèmes nationaux au détriment des ambitions tribales.
Il n’en sera rien ! L’école ne servira plus dès lors à créer des citoyens, mais des fonctionnaires assimilables par leur dévouement aveugle à des milices administratives au service d’un pouvoir dont on n’a jamais su s’il incarnait une république ou un califat ; cette ambiguïté permettra, en fonction des choix politiques du moment, de manipuler la constitution, perçue tantôt comme le contrat social, tantôt comme un pacte d’allégeance dans un rapport de vassalité du peuple au chef de l’Etat, à l’identique de la relation entre la « oumma » et le calife.
Cette ambiguïté devenue existentielle, est au centre des règles de gouvernance ; il y a d’un côté ceux qui croient ou veulent croire que la Mauritanie est une république où c’est la constitution qui organise le fonctionnement des institutions , et d’un autre côté, ceux pour lesquels, la république est incompatible avec l’Islam qui ne connaît qu’une seule forme de gouvernance : le califat ; des indépendances à nos jours, la Mauritanie navigue ainsi entre deux eaux, ballotée par deux courants dont l’un est d’obédience islamiste prenant parfois des allures arabo-nationalistes, produit pur et dur de la medersa originelle attachée à la naissance d’un califat, et l’autre, résolument constitutionnaliste, attaché à l’émergence d’un Etat de droit.
Le résultat est là ; la Mauritanie n’est ni un Etat de droit, ni un califat, et cette situation de ni-ni se perpétue des indépendances à nos jours, affectant la lisibilité des institutions ; c’est ainsi que dans chaque texte de loi, on trouve deux rapports de droit , celui de la loi « stricto-sensu » telle que proclamée par l’assemblée nationale, expression suprême de la volonté du peuple, et celui de la charia telle que révélée dans le coran, et illustré par la jurisprudence (Fikh), figurant en bonne place dans le préambule de la constitution comme « étant la seule source de droit » ; or chaque fois qu’un rapport de droit présente des points de contact avec plusieurs systèmes juridiques, le texte censé régir ce rapport gagne en ambiguïté.
A titre d’exemple ; en droit islamique, la prohibition du prêt avec intérêt est d’ordre public, alors qu’en Mauritanie , le code des obligations et des contrats limite cette interdiction aux prêts conclus entre personnes physiques.
Saisi d’un litige portant sur un prêt avec intérêt dont le débiteur soulève le caractère d’ordre public de la nullité sur le fondement de la charia, la question se posera au juge de savoir s’il faut annuler le contrat en faisant une application stricte des prescriptions du droit islamique, ou si préalablement à l’examen au fond, il devrait déterminer le caractère moral ou pas des parties au contrat de prêt, et rejeter l’annulation de la convention dans la première hypothèse, ou la retenir le cas échéant.
Dans ces conditions, les parties sont à la disposition du juge qui aura la faculté de privilégier l’une ou l’autre des solutions sans égard pour les moyens soulevés par les plaideurs ; le juge aura la latitude d’annuler le contrat parce que cette annulation relève de l’ordre public, selon la charia, comme il aura la latitude de valider le prêt, si les parties sont des personnes morales, conformément aux dispositions de la loi portant code des obligations et des contrats.
Qu’en sera-t-il si l’une des parties est une personne morale et l’autre, une personne physique ? Le code des obligations et des contrats est à cet égard silencieux, ce qui laisse la porte grand ’ouverte à une appréciation discrétionnaire du litige par le juge saisi.
Ce schisme structurel explique à bien des égards l’absence de sécurité juridique due au manque de prévisibilité des décisions émanant des pouvoirs exécutif, judiciaire ou législatif, pouvant s’articuler sur le fiqh malékite, ou au contraire sur le droit positif, selon l’orientation politique du moment ou la culture juridique du juge chargé d’examiner le litige; cela entame gravement la lisibilité des institutions……………
*Avocat à la Cour.
*Ancien membre du Conseil de l'Ordre.
Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité.