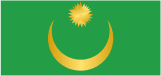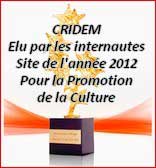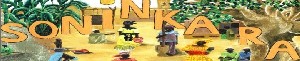06-10-2025 23:59 - Education : Orienter la boussole d’un système !

LE RÉNOVATEUR QUOTIDIEN -
À chaque rentrée, la promesse revient, inaltérée, presque rituelle : l’école sera sauvée. La ministre de l’Éducation et de la Réforme du Système Éducatif, Mme Houda Babah, n’a pas dérogé à cette tradition.
Dans un discours aux accents volontaristes, elle a réaffirmé la priorité nationale que constitue l’éducation, tout en énumérant les avancées de l’année écoulée et les ambitions pour celle à venir.
Mais à force d’entendre que l’école est « une priorité », sans que les fondements structurels ne changent vraiment, le scepticisme s’installe.
Car réformer ne consiste pas à multiplier les mesures. Réformer, c’est bâtir une vision, ancrée dans le réel, portée par une ingénierie solide, lisible, assumée. Or, c’est précisément ce qui fait défaut à la réforme éducative actuelle : une boussole claire et partagée.
La réforme engagée en Mauritanie a des vertus : revalorisation des enseignants, modernisation administrative, ajustement des curricula, et même une timide percée vers l’introduction des langues nationales. Mais à regarder de plus près, l’impression persiste que la mise en œuvre ne suit pas le rythme des annonces. Trop de déclarations, pas assez de preuves. Trop de projets, pas assez d’évaluations. Et surtout, trop d’idéologie, pas assez de pédagogie.
Prenons l’exemple des langues nationales : sur le principe, personne ne conteste l’impératif de justice culturelle, ni la nécessité de réconcilier l’école avec la diversité linguistique du pays. Mais à quoi sert une mesure symbolique si elle reste sans plan de formation, sans outils pédagogiques, sans cadre d’évaluation ?
L’école n’est pas un champ d’expérimentation identitaire. C’est un lieu de savoir, d’égalité des chances et de rigueur. L’intention ne suffit pas, et l’amateurisme n’est plus permis.
Autre faiblesse criante : la persistance des fractures territoriales. Dans certaines régions, l’école publique est un mirage : classes surchargées, manuels absents, enseignants démotivés, infrastructures vétustes. À quoi bon parler d’école républicaine si l’accès à une éducation décente reste conditionné au lieu de naissance ?
Plus globalement, la réforme semble souffrir d’un défaut de cap stratégique. L’on réforme par petites touches, sans hiérarchie claire des priorités, sans indicateurs de réussite crédibles, sans calendrier maîtrisé. On parle d’école inclusive, mais les élèves les plus vulnérables restent les oubliés du système. On évoque la qualité, mais sans s’attarder sur la formation initiale des maîtres, sur l’encadrement pédagogique, sur la maîtrise des apprentissages de base.
C’est là que réside l’essentiel : la réforme éducative ne sera crédible que si elle s’attaque aux fondamentaux, loin des logiques de communication ou des équilibres politiques à satisfaire. L’école n’a pas besoin d’effets d’annonce. Elle a besoin d’enseignants bien formés, d’élèves bien encadrés, d’outils bien conçus et d’une administration qui fonctionne.
Le président de la République a, lui aussi, fait de l’éducation un pilier de son programme. Mais la légitimité politique ne suffira pas à faire de cette réforme un succès. Elle devra convaincre par ses effets, pas par ses discours. Le défi est immense, mais il est à la hauteur de l’enjeu : refonder le socle républicain par une école réellement équitable, exigeante et émancipatrice.
Réformer l’école, c’est faire preuve de courage, pas seulement de bonne volonté. C’est choisir la profondeur sur l’affichage. C’est accepter le temps long, mais aussi rendre compte à chaque étape. C’est, surtout, placer l’élève au cœur de tout. Le reste – promesses, postures, proclamations – n’est que bruit.